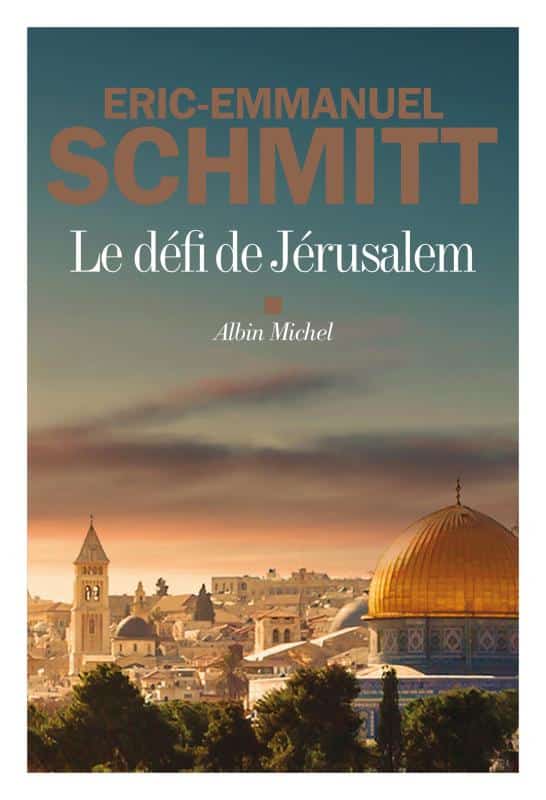Atelier de Lectures Oecuménique du 4 avril 2024
“Vie de Jude, frère de Jésus”
Françoise Chandernagor
(Albin Michel 2015)
présenté par Patricia Deplace
Introduction
Ce livre est un roman dont les héros sont les quatre frères de Jésus : Jacques, José, Simon et Jude. Tous appartiennent à l’Histoire, leur existence, ainsi que celle des sœurs, est attestée par de nombreux textes canoniques, les Evangiles les plus anciens Mc et Mt (Mt13, 55-56) les Actes des Apôtres, deux des Epitres de Paul, l’Epître de Jacques, entre 60 et 85, et l’Epître de Jude, années 60-70, attribuées à deux des frères, selon les exégètes de la TOB. Cette dernière fut largement reprise dans la 2è Epitre de Pierre (écrite au 3è siècle).
Parmi les 150 apocryphes, plusieurs parlent des frères de Jésus, de Jacques surtout, comme l’Evangile de Thomas. Flavius Joseph, juif rallié aux Romains dès 67, détaille les circonstances politiques de la mort en 62, de Jacques « frère de Jésus appelé Messie». Pendant plus de 300 ans, les Pères de l’Eglise ont évoqué les frères de Jésus, la lapidation de Jacques le Juste « le frère du Seigneur » sur l’ordre du parti sacerdotal, et Jude «frère du Seigneur selon la chair». Jacques fut le chef de l’Eglise de Jérusalem en un temps où la Rome chrétienne n’existait pas.
Au soir de sa vie, Jude, raconte pour sa descendance dispersée parmi les incirconcis des Nations.
Il me restait à imaginer la vie de cette famille peu ordinaire dans la Palestine occupée par les Romains.
Présentation de l’auteure
Née le 19 juin 1945, d’un père ministre des affaires européennes du gouvernement Pierre Mauroy, Françoise Chandernagor entra à 21 ans à l’ENA ; en sortant Major de sa promotion, elle fut la 1ère femme à obtenir ce rang.
Après plusieurs années au Conseil d’Etat, elle quitte le droit et la magistrature pour se consacrer à l’écriture. Elle est membre depuis 1995 de l’académie Goncourt. Traduits en une quinzaine de langues, ses romans peignent les sociétés passées ou contemporaines. Historienne avertie, maîtrisant parfaitement ses sources, et romancière puissante, elle nous conduit dans la Judée du 1er siècle, nous montrant un monde déchiré et violent où l’annonce du Royaume le dispute à la tentation de l’Apocalypse. Son livre aux dialogues abondants, riches en humanité et spiritualité, adopte un style propre aux récits bibliques. Elle se base sur la Bible de Genève, répandue chez les protestants francophones, la Bible Osty respectant les hébraïsmes de l’AT et la structure de la phrase grecque du NT, ainsi que sur la TOB aux notices remarquables. Aucun discours indirect. « L’atelier de l’auteur », très apprécié des critiques, explicite les personnages et ses divers choix.
Présentation des 5 livres
Découvert en 1950 dans un tombeau en Égypte, le manuscrit de la « Vie de Jude » est un ensemble de feuillets rédigé en copte, langue populaire de l’Égypte, certains mots sont en hébreu, d’autres plus nombreux en araméen, d’autres en grec probablement la langue originale du texte. Une analyse scientifique du papyrus et du cuir conduit à dater le manuscrit du IVè ou Vè siècle mais l’original grec du texte pourrait dater des années 75 à 85 de notre ère, comme les plus anciens textes canoniques. La disparition de plusieurs feuillets nous indique que Jude quitte sa famille pour suivre son frère aîné, devenant sinon l’un des 12 apôtres du moins l’un des premiers disciples de Jésus. Ce papyrus subit bien des détériorations. Ayant mieux résisté au temps, les 3è et 4è Livres reprennent le récit depuis la Résurrection jusqu’aux années qui précédèrent l’arrestation de l’apôtre Paul. Le rôle éminent de Jacques, qui devint le premier « évêque » de Jérusalem, y apparaît clairement. Le 5è Livre, plus endommagé, retrace les événements dramatiques de la guerre des Juifs contre les Romains, la destruction du Temple, et le sauvetage par Jude d’une communauté judéo-chrétienne réduite et peu à peu marginalisée.
Repères par les sous-titres pages du livre de poche
Premier Livre : de Nazara à Képharnaüm p 11 à 80
La famille
La responsabilité éducative de Jésus, après la mort de Joseph
Mariages des frères Jude vit son 1er pèlerinage à Jérusalem
Disettes Jésus dit être la bouche inutile
Recherche du Royaume dans le désert de Juda
Jean le Baptiste
Jésus revient au village José exige sa part d’héritage
Jésus à Képharnaüm Quittant les Esséniens, Jude retrouve Jésus Marie de Magdala
Guérison de Jacques
Deuxième Livre : de la prédication à la Passion p 83 à 149
Prédication en Phénicie Jude quitte son village et suit jésus Talitha
Echec de la mission de Sidon Tabitha se joint aux disciples
Jude avoue son amour pour la Syro-Phénicienne
Jude accompagne Jésus en Pérée (Jordanie), puis en Samarie
Mort de Simon quatrième des cinq frères
Jésus : « qui-suis-je ? »
Jude demande à épouser Tabitha Jacques se joint aux disciples
Les Rameaux Perfidie des villageois
Jours avant la Pâque La «purification» du Temple
Bar-Timée, de Jéricho, renseigne Jude Jude entend Jésus prédire la destruction du Temple
Le dernier repas
Guétsémani Le procès
Dans le jardin de Jonathas Golgotha
Troisième Livre : de Pâque à Pentecôte 1er martyr Etienne mort de Marie p 153 à 217
Jacques et Jude se retrouvent Pierre revient vers Jacques, qui réconforte et décide
Jésus n’est plus au tombeau Jésus apparait à Marie de Magdala
Apparition aux disciples d’Emmaüs
Apparition à 4 disciples au lac de Galilée attente à Jérusalem les yeux de Marie voient la lumière
Apparition à Jacques Matthias est choisi comme 12è des Douze
Dans l’attente du Jour du Seigneur Pentecôte
Pierre témoigne devant la foule Jacques témoigne au Temple
La communauté s’organise Parler en langues : 1èr différend entre les saints
Les Pauvres de Jérusalem communauté des biens de la qéhila (ekklesia)
Soutien des femmes aux veuves Marie attend le retour de Jésus les « trois colonnes »
Remontrances des baptistes sur notre baptême
Forte présence des Hellénistes ardeur d’Etienne diaconie
Diversité des dons et de ministères
L’Ecriture s’accomplit
Mort d’Etienne Persécution et dispersion
Reprise en main miracle de Pierre et Jean
Mort de Marie
Quatrième Livre : Missions dans les nations ; Paul p221 à 293
Faux-prophète et massacre Envoi en mission
Découverte de la fin du rouleau d’Isaïe
Saül
Pierre envoie Marc à Cyrène, accompagné de Jude
Refus de statues grecques dans le Temple de Jérusalem Famine
Retour de Saül à Jérusalem
Mort de Jacques de Zébédée Arrestation de Pierre Fuite de Jean de Zébédée, puis de Pierre
Face à la menace, fuite des disciples Jacques garde la maison
Saül se fait appelé Paul à Cyrène, Jude s’oppose aux riches de la synagogue
Jude s’occupe des pauvres A Tyr, José convertit artisans et marchands
Jude à Antioche les juifs n’acceptent pas les incirconcis à leur agape Jude à Jérusalem
Paul : Jésus Sauveur Paul et les non circoncis
Danger des faux apôtres Jude rassemble les « loggia » de Jésus accueil des non circoncis
Témérité de Paul juifs et païens à la même table Concile de Jérusalem
Cinquième Livre : Joug de Rome Guerre des Juifs Bonne Nouvelle de Marc p 297 à 370
Humiliations et outrages au peuple de Jérusalem départ de Pierre, Jean, et des fils de Jude
Paul déclaré faux apôtre : mode du baptême, des mots «Jésus, Seigneur», la foi et les œuvres
Paul critiqué : « Jésus, Fils de Dieu » ; le joug de la Loi ; circoncision ; accusé au Temple ; arrestation
La guerre des juifs ; colère de Jacques contre les grands Prêtres et les riches, lapidation de Jacques
Incendie de Rome, Persécutions des chrétiens, Mort de Pierr
Autour de Jude, les ébionim attendent le Royaume massacres des juifs, des romains, des juifs
Refuge à Pella
Destructions et atrocités à Jérusalem mort de José, mort de Joël fils de Jude
Divisions crées par Paul à propos de «Christ, fils de Dieu, est Seigneur» ; exclusion des synagogues
Jérusalem en ruine ; rejet des nazôréens des synagogues ; Bonne Nouvelle de Marcus ; Soif de Jésus
L’atelier de l’auteur p 371 à 419
Roman fortement documenté ; indication des sources
Evolution historique de la considération des frères de Jésus p 374 ; 380
Evolution historique et spirituelle de Marie, mère de Jésus, Vierge éternelle p 375 à 378 ; 383 ss
Position des exégètes catholiques p 387
Choix de l’auteur concernant les sœurs, José et Simon p 388
Synthèse sur Jacques p 388-389-390
Synthèse sur Jude p 390-392
Style du discours direct p 393-394
Imitation des notes de celles des vraies Bibles p 395
Syntaxe et vocabulaire ; modèle sur les trois synoptoques et les Actes des Apôtres p 396-397à 399
Montrer concrètement la vie des juifs sous l’occupation romaine p 400
Avec les conflits théologiques, politiques et économiques
Quelques mots sur Marie Madeleine p 410
A propos de Marie, mère de Jésus p 411-412-413
A propos de Paul p 416
En conclusion : Lire p 406 (bas), haut-milieu p 407 pour le Jésus « historique » ; « or à quoi arrivais-je » p 408
Lire p 416 « en bas « les pères de l’Eglise », puis la fin de la page 419
Premier Livre :
de Nazara à Képharnaüm
La famille
Je suis né dans un village de la Galilée, 5è fils de mon père et le 7è de ses enfants vivants, sous le gouvernement d’Hérode Antipas. Voici les noms de mes frères : Jésus, Jacques, José et Simon. Lorsque Marie, ma mère, enfanta son fils Jésus, elle avait environ 14 ans et, quand elle m’enfanta, mon frère Jésus avait atteint l’âge de 19 ans. Mes sœurs,nées avant Jacques, données en mariage à des veufs pieux, furent enceintes avant ma conception. Mon père, Joseph, homme juste issu du roi David, charpentier, mourut peu de jours avant ma naissance. Jacques, José et Simon n’étaient que des enfants. Jésus renonça alors à son désir de chercher la voie du Seigneur et par son travail, soutint seul toute la famille, faisant l’aumône aux miséreux malgré notre pauvreté. Ma mère travaillait comme une servante, chantant la grandeur de l’Eternel et la splendeur de Jérusalem. Jésus et Jacques avaient été nazirs dès son ventre pendant 7 ans. Notre père fit à Jérusalem les offrandes et mes frères furent relevés de la promesse de notre mère. Comme José et Simon, je ne fus pas «nazir» car devenus trop pauvres, nos parents ne pouvaient plus faire l’offrande
La responsabilité éducative de Jésus, après la mort de Joseph
Avant de mourir, mon père avait dit à Jésus « je t’établis comme père sur tes frères». Jacques n’oublia pas la promesse d’obéissance. Jaloux, José l’oublia souvent. Jésus dut le châtier pour ses méfaits. A Nazara, le jour du sabbat, à la synagogue, parlant pour la 1ère fois devant les Anciens et les chercheurs de la Torah, il dit avec autorité «prions pour ceux qui nous insultent et pardonnons», puis il posa sur José un regard d’une grande douceur. Mais José entraînait Simon dans la révolte et l’envie. Mon frère aimé du Seigneur résolut de les séparer. Jésus m’incitait à bien écrire l’araméen et l’hébreu, mais il ne voulait pas que je devienne scribe ou docteur. Plus tard, il me demanda de lire les chants du prophète Isaïe, m’expliquant le sens des mots. Jacques m’instruisait aussi. José refusa d’étudier les Ecritures. Resté révolté, il ne voulait rien recevoir de ses frères. Simon l’imita.
Mariages des frères Jude vit son 1er pèlerinage à Jérusalem
Jacques épousa Sara, que Jésus avait choisie pour lui. José épousa la fille unique du potier, habita avec eux. Lisant seul le rouleau d’Isaïe, j’étais épouvanté par la violence des épreuves annoncées. Jésus m’apaisa sans me tromper «Dieu sauvera de la désolation les saints et les justes, les repentis et les rachetés». Il priait «Père que j’aime, permets moi de restaurer ton royaume. Laisse-moi aller vers tes enfants perdus». N’ayant jamais entendu personne appeler «Père» le Très Haut, je crus qu’il avait parlé à Joseph. Puis ce fut la Pâque, pour la 1èrefois, j’ai pu aller à Jérusalem. Je me taisais; les Judéens ne pouvaient se moquer de mon accent de galiléens, nous prenant pour ignorants et demi-païens.
Disettes Jésus dit être la bouche inutile
Vint la 7è année, sabbat de la terre d’Israël, la 8è fut celle de grandes disettes dans tout le pays. Notre misère était à son comble. Jésus acheta du blé à des Grecs. Les riches et égoïstes beaux-frères le critiquèrent durement. Jacques le regarda avec défiance; craignant Dieu, il ne jugeait jamais trop lourd le joug de l’Eternel. Tous amaigris par la faim, Jésus dit à notre mère «je suis la bouche inutile» et partit. Il fut accusé d’abandon par nos beaux-frères et cousins. La sœur de notre mère le défendit «hommes durs, vous ne l’aimez pas parce qu’il n’est pas comme les autres». Sur le Royaume dont Jésus parlait, ma mère dit qu’il n’était qu’un enfant, au temps où le César ordonna le recensement des terres pour son impôt. Yéhouda le Galiléen souleva le peuple contre lui, les soldats romains le châtièrent par de nombreux hommes crucifiés le long des routes. Alors Jésus se mit à parler d’un Royaume de Justice. (en 6 de notre ère, Jésus avait 10 ans)
Recherche du Royaume dans le désert de Juda
Jacques m’envoya étudier les Cinq Livres de Moïse chez un hazzan. J’avais 11 ans passés. Un jour, un Judéen d’Hébron, dit «Ton frère a vécu dans la solitude du désert très austèrement. Sitôt guéri de la fièvre, il a marché au nord de la Mer Salée.» J’ai pensé qu’il voulait rejoindre les Fils de Lumière, ces chastes serviteurs du Très-Haut, retirés au-dessus de la ville. Simon travaillait avec José devenu artisan potier. Léa, la femme de José restait stérile. Simon se maria à l’âge de 17 ans. Nous étions accablés de fatigue et rassasiés de pauvreté. J’ai prié l’Eternel pour que vienne notre délivrance.
Jean le Baptiste
On parlait d’un prophète appelé Jean le Baptiste. Je pensais qu’il était nazir, d’un vœu prononcé à vie. Il prêchait d’une voix rude, invectivait les sacrificateurs du Temple, les lévites et les sadducéens de Jérusalem, exhortait à la pénitence. Par l’eau du baptême, il demandait que Dieu purifie. Des Galiléens vivaient avec lui, baptisant en attendant un monde nouveau. Je ne savais pas que mon frère Jésus était parmi eux. J’ai demandé à Jacques la permission d’entendre le Baptiste. Il était comme une muraille, qui renferme mais protège.
Jésus revient au village José exige sa part d’héritage
Un soir, vinrent trois hommes chevelus et mal vêtus, je ne reconnus pas mon frère Jésus. Notre mère, nos frères et nos sœurs écoutèrent comment ils avaient été disciples de Jean le Baptiste, allant depuis sa mort de village en village en fuyant les soldats d’Hérode. Irrité, José exigea de Jésus la part d’aîné du bien de leur père. Jésus lui dit «sois béni mon frère. Il est bon que je sois délivré de tout bien. Tel est le dessin du Très-Haut». La main sur l’épaule de Jacques, il lui dit «tu es trop sage, Dieu vomit les tièdes et leur cache sa face» Alors José lui montra le poing : «qui t’a fait le rabbi de tes frères, paresseux, hypocrite ?» Ma mère pleura. Tous se dispersèrent. Le lendemain, Jésus me serra dans ses bras et dit « fils ne garde pas rancune à José. Ce qu’il a fait, il avait à le faire». J’avais vécu près de 14 ans et voulais purifier mon âme par le voyage et la prière, me rapprocher du Serviteur de Dieu et de celui qu’il appelait son Père. Jacques s’entretint en secret avec ma mère et me permit de quitter la maison jusqu’à la moisson suivante.
Jésus à Képharnaüm Quittant les Esséniens, Jude retrouve Jésus Marie de Magdala
Jésus était à Képharnaüm, dans la famille d’André, venu chez nous, et disciple de Jean le Baptiste. Il avait un frère Simon, associé à Zébédée, un autre pêcheur qui demeurait à côté avec Salomé sa femme, ses fils Jacques et Jean, âgés d’environ 15 ans. Alitée par une violente fièvre, la belle-mère de Simon fut guérie par Jésus qui lui toucha la main, elle se leva. Alors il crut et demanda à Jésus de rester. Jésus parcourait le pays pour guérir et porter la bonne nouvelle du Royaume. Il imposait les mains au nom du Très-Haut et remettait les péchés sans verser d’eau. J’étais établi chez les Fils de Lumière, à Jérusalem près de la porte de Sion. Je savais qu’ils étaient les ennemis des sadducéens. Je voulais connaître leur doctrine car Jean le Baptiste avait vécu dans une de leurs maisons avant de se retirer au bord du fleuve. Hélas, ils ne construisaient l’Israël du Seigneur que pour eux, bien à l’abri de la misère et du malheur. Jean le Baptiste n’avait pas gardé leur enseignement, voulant par le repentir du baptême sauver tous les enfants d’Abraham même les publicains, brigands et sacrificateurs. Je quittai ce nid étroit sans amour et repris le chemin de la Galilée.
La belle-mère de Simon m’envoya dans la maison de Marie, veuve d’un riche saleur de Magdala. Elle avait de l’âge et de l’autorité. Chez elle, on entendait les cris de douleur des blessés dont on lavait les plaies, le râle des enfants perdant le souffle et les gémissements des paralytiques. Je dis «d’où vient que le serviteur de Dieu se souille de la sorte ?» La Magdaléenne répondit que le Maître dit «ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades. Je veux entrer dans la maison des égarés, embrasser ceux qui se croient indignes de me recevoir». Je dis à Jean et Jacques, les associés de Simon-Pierre, «Priez-le, ton frère Jude a faim de ton amour».
Guérison de Jacques
La blessure de Jacques à la jambe, quand la poutre s’était abattue sur lui, ne guérissait pas. Il ne pouvait plus se lever, la maladie était à la mort. Priant près du muret de la vigne, Jésus dit «je suis venu dès qu’on m’a dit que tu voulais être nourri». Je dis «Rabbi, je te prie seulement de guérir Jacques. Je t’en supplie: si tu le peux, sauve-le !» Jésus dit «Jude, enfant de peu de foi ! Pourquoi m’appelles-tu Rabbi si tu n’as pas confiance en moi!» Je m’écriai «Béni du Seigneur, je croirai ce que tu m’enseigneras, je ferai ce que tu voudras, sauve Jacques». Pris de compassion, il posa sa main sur la main de notre frère, dit avec autorité «Jacques, lève-toi, je te l’ordonne». Jésus dit «Abba est vivant, Jacques, il est vivant! Marche». Joyeux, tous partagèrent le repas. Pour la première fois, José regardait notre aîné avec respect.
Deuxième Livre :
de la prédication à la Passion
Prédication en Phénicie Jude quitte son village et suit jésus Talitha
A Jean, le plus jeune des Douze, je dis : pourquoi notre rabbi se retire-t-il dans ce territoire d’impies ?» Il dit «Dans tous les ports de la Grande Mer, aux enfants d’Israël dans la Diaspora, André parle dans la langue des Grecs, ainsi le Maître les enseigne». Les principaux de la synagogue ne nous recevaient pas, craignant notre impureté pour être entrés dans la maison d’un sans-Loi. Jésus dit avec colère: aux prêcheurs de la synagogue, «vous liez des fardeaux sur les plus petits, disant c’est la tradition qui l’exige. Notre Père nous a donné la Loi! La Loi est la parole du Père, la tradition le balbutiement des fils. Furieux, des scribes dirent «Qui t’a donné autorité ?» Des Grecs de Syrie, des craignant-Dieu, et leurs malades, non circoncis, furent chassés de la synagogue. L’Elu du Seigneur ne s’approcha pas d’eux, il ne voulait pas scandaliser les petits d’Israël, car il était venu pour les brebis perdues de notre maison, pas pour les païens. Jésus fut interpellé par une femme grecque, phénicienne d’origine, lui demandant de libérer sa fille de 12 ans cruellement tourmentée par un démon. André insista pour que le rabbi renvoie la femme. Se tournant vers sa maison, Jésus d’une voix forte «jeune fille, lève-toi» puis dit à la femme «va maintenant parce que tu as cru, le démon est sorti de ta fille» Sur-le-champ, la fillette fut guérie et vint sur le seuil. Je devins amoureux de Lydia-Talitha (jeune fille). Jean de Zébédée me mit en garde, je m’éloignais de la fillette. Il me dit « considère qu’en tout lieu, tu n’es qu’un voyageur. Nul ne peut se dire mon frère s’il ne s’est fait errant, mendiant, étranger, passant».
Echec de la mission de Sidon Tabitha se joint aux disciples
Le jour du sabbat, des pharisiens et un lévite nous reprochèrent d’avoir touché des lépreux et de ne pas avoir ordonné pour leur purification ce que Moïse avait prescrit. Une grande foule nous accusa de souiller la ville, certains nous jetèrent des pierres cherchant à nous tuer. Beaucoup vinrent à nous, chacun voulait nous recevoir dans sa maison. Sa mère décédée, Lydia voulut suivre le Maître. Marie lui dit «que sais-tu, ma fille, de notre doctrine? Jean s’écria «pouvons-nous prendre une syrienne qui n’est pas la fille d’un circoncis?» Mais elle connaissait toutes les prières de la synagogue. Marie eut compassion de sa jeunesse et la prit dans sa maison. J’avais environ 16 ans, des femmes se moquèrent de moi, car je n’avais ni femme, ni enfant Je pensais à Talitha, qu’elle souillait par leur risée.
Jude avoue son amour pour la Syro-Phénicienne
Mon frère, béni du Très Haut, entouré de malades, de mendiants, m’embrassa. Je dis comme un insensé «pour qui as-tu ouvert ta main ? D’où viens-tu ?» Alors changeant de visage, il dit «moi, je sais d’où je viens, toi tu ne sais pas où tu vas». Confus, je dis «Jésus ne sois pas irrité contre moi, je n’ai pas péché avec l’étrangère. Rabbi, laisse-moi épouser la Jeune-Fille, ne lui tiens pas rigueur d’être née dans les Nations, elle craint Dieu depuis toujours et elle attendra le Royaume avec moi» Tiens-toi prêt Jude et rassemble autour de l’arche tous ceux qui veulent être sauvés Malheur à l’âme qui dépend de la chair !».Laissant Talitha derrière moi.
Jude accompagne Jésus en Pérée (Jordanie), puis en Samarie
Trois fois Jésus me dit «Jude, bar-Joseph, m’aimes-tu?» Je dis «mon frère je t’aime depuis que je suis né !» Il dit «veille sur toi, petit», la 2è fois, je dis «Rabbouni, tu sais bien que je t’aime !», il dit «veille sur moi, mon frère». La 3ième fois, je dis «Béni du Seigneur, tu es l’Elu de Dieu, il te donne connaissance de toutes choses, tu sais combien je t’aime» Il dit «veille sur mes agneaux, fils» et il s’endormit. Amer quand l’Elu du Seigneur laissait Jean persuader qu’il était son disciple préféré, je voyais qu’il se donnait à tous les autres alors que j’aurais voulu avoir mon frère pour moi.
Mort de Simon quatrième des cinq frères
Simon, 20 ans, venait de mourir. Près de la rivière; il avait une seule plaie, sa ceinture dérobée et les franges de son manteau coupées. Jésus me dit «Dans ce temps-ci, le Père nous rendra au centuple les frères que nous aurons perdus et dans le temps à venir, il donnera à tous, vivants et morts, la vie éternelle. Aie foi!»
Jésus : « qui-suis-je ? »
Au pays de Damas, nous demeurions chez le chef de la synagogue, proche des pharisiens de Gamaliel. Il avait porté tous ses fils au tombeau et espérait dans la résurrection des morts. Jésus aimait cet Ancien et me demanda «qui suis-je au dire de cet homme ?» Je dis «Un grand prophète, Rabouni» Il dit «et mes disciples qui disent-ils que je suis ?» «Pour Petit-Jacques, le Baptiste ressuscité. André voyant que tu remets les péchés sans verser d’eau, dit «le Rabbi n’est pas le Baptiste, il est le nouveau Moïse qui vient pour restaurer la Loi». Simon et Judas disent «cet homme est le fils de David, qui délivrera Israël du joug des Nations. Matthieu, qui lit les prophéties, dit «il est le Fils de l’homme qui nous est promis à la Fin des temps» Pierre, qui ne connaît que quelques oracles, «Moi qui ne sais rien, je sais que le nom de notre Rabbi est Messie». Jésus s’écria «ne répète ce mot à personne, la langue est un piège de mort !» Il me demanda «pour toi, qui suis-je ?»Comme un homme qui se noie et appelle à l’aide, je dis «tu es celui que mon cœur aime». Jésus sourit puis s’assombrit «cependant, tu me quitteras; en vérité, tu m’aimes mais ne me préfères pas».
Le soir, me sentant solitaire dans la multitude, je recommençais à songer à la Jeune-Fille.
Jude demande à épouser Tabitha Jacques se joint aux disciples
Les fils de Zébédée méprisaient la syro-phénicienne. Je dis «je désire être avec elle jusqu’à l’avènement du Royaume !». Judas l’Iscariote et l’autre Judas, surnommé Thomas, dirent à Jésus «Se peut-il que tes commandements soient différents pour tes frères de sang ?» Jésus se tourna vers eux, sa voix taillait des lames de feu «êtes-vous sans intelligence ? Vous jugez selon la chair, moi je sais ce qui est dans le cœur de chaque homme. Si sa chair est faible, son cœur est ardent, il finira par entendre la parole du Père». Jacques dit «guéri de ma blessure, la vie qui m’a été rendue appartient à l’Eternel et à toi, le saint qu’il a choisi pour sauver son peuple. Rabbi, laisse Jude auprès de notre mère, avec la femme que nous lui donnerons pour épouse. Enivré, José, s’insurgea. Jésus dit avec colère « Apprends que la fillette est purifiée depuis que sa mère et elle ont mangé une miette de notre pain. Même en Israël, je n’avais pas trouvé une aussi grande foi ! Je sus que Jésus m’aimait comme il aurait aimé un fils. Ayant vu la guérison de Jacques, José commençait à croire en Jésus mais il espérait que notre bien-aimé deviendrait roi d’Israël, combattrait les païens avec l’épée et le bâton. Soupirant, José dit «allons à Jérusalem. Montre-toi aux principaux du Temple pour qu’ils voient tes œuvres et en soient troublés» Jésus dit «mon temps n’est pas encore venu». Il demeura en Galilée avec Pierre, André et Jean de Zébédée, disciples en qui il se fiait de préférence à tous. Il garda Jacques auprès de lui.
Jude et sa jeune épouse Tabitha rentre au village
Talitha se purifia selon le rite et donna les vêtements précieux reçus en cadeau à Matthieu, qui les vendit pour les pauvres et les malades de la Magdaléenne. De retour au village, à ma mère, assise sous le figuier, je dis «Mère voici ta fille», à Talitha «Femme, voici ta mère». Ayant mal entendu, ma mère l’appela Tabitha, signifiant «gazelle»; qui resta son nom pour tous. Ma mère donnait aux pauvres du village. Elle vieillissait, dormait peu. Pleine de joie, elle disait «Jésus leur donne un cœur nouveau !, il hâte le temps du Royaume, les délivre de leurs péchés et de leurs démons. Aux petites gens comme nous, il parle en paraboles et tous le comprennent.»
Les Rameaux Perfidie des villageois
Le chef de notre synagogue dit à notre mère: «des pèlerins montés à Jérusalem, ont accueilli un prophète avec des transports de joie. Ils l’appelaient Jésus, Fils de David et agitaient des rameaux d’olivier. Quand il se déclarera roi, je me prosternerai à ses pieds.» Dès qu’il partit, ma mère se mit à rire des paroles de ce menteur. Un muletier lui dit «sur l’impôt, ton fils a conseillé de donner au César le denier exigé. José s’indigna. Je lui dis «Le Béni du Seigneur a pris ces hypocrites à leur piège : s’ils ont entre leurs mains la monnaie impure des Romains, eux qui craignent tant de se souiller, qu’ils la leur rendent! Qu’ils rendent à Dieu ce qui est à lui : cette terre d’Israël où nous bâtissons le Royaume». Le muletier : «pour certains, ton fils est un ivrogne et un luxurieux car il ne jeûne pas comme le Baptiste, n’écarte pas de lui les mauvaises gens». Elle dit «Jésus sait ce qui est juste. Que de pièges et trappes autour de lui !»
Jours avant la Pâque La «purification» du Temple
Une grande confusion cacophonique entourait le Temple, au-dessus duquel se tenaient les soldats romains, comme des idoles de pierre. Comment l’Eternel aurait-il reconnu son tabernacle ? Les agneaux et colombes étaient vendus dix fois plus chers. Je vis l’esplanade des païens agitée de mouvements contraires. Une vieille judéenne me dit «C’est le prophète, ce Galiléen qui se prétend fils de David et se prend pour Moïse. Il a parlé du Veau d’or, alors que nous faisions tranquillement nos affaires». Il criait : «Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs!» En agitant le peuple, il attirera sur nous la colère des romains»
Bar-Timée, de Jéricho, renseigne Jude Jude entend Jésus prédire la destruction du Temple
Jacques dit «nous voilà exposés à tomber: le berger et ses brebis seront également frappés ». Le Maitre prend son repos à Beth-Ania dans la maison de Simon, le Lépreux, qu’il a guéri. Aucun lévite n’ira le chercher là-bas, ils craignent trop de se souiller !» Pâque approchait. Ma mère, trop lasse, restait dans la tour du pressoir de Jonathas.
Jésus enseignait sous la colonnade où se trouvaient les maîtres de sagesse. Il s’irritait contre ceux qui lui tendaient des pièges». Il dit «les jours viendront où, de ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, même le sanctuaire sera ravagé !» Le lévite cria «que veux-tu, Galiléen, détruire ce Temple ? Insensé! Faux prophète !»
Le peuple de Judée se divisait à propos de Jésus : pour certains, «il est Elie redescendu des Cieux ! » Mais beaucoup s’écriaient «il a un démon, il est fou !». Les sacrificateurs et les scribes disaient «Accusons celui qui veut être roi d’Israël et jette le trouble dans nos parvis !» Ma mère se mit à prier «Eternel, beaucoup de fils d’Israël sont encore à sauver N’abandonne pas si tôt ton enfant aux oppresseurs.». Elle s’endormit près du feu, et je m’endormis.
Le dernier repas (Le récit qui suit, Jude le tient sans doute de Jacques)
Ayant rendu grâce, triste, l’Elu du Seigneur dit «je sais que mon heure est proche. Que votre cœur ne s’alarme pas : ceux qui m’aiment garderont ma parole. Assemblez-vous lorsque vous aurez faim, car je suis le pain qui nourrit. Et vous, enfants, quand vous serez réunis tous ensemble, vous serez ma chair et mon sang. La flamme brûlera et jamais elle ne s’éteindra.» Pierre dit «moi, je ne te quitterai pas même s’il fallait mourir pour toi»; Le reprenant, Jésus dit «Simon quand je partirai, Satan te réclamera pour te passer au tamis. Je prie pour que tu ne défailles pas lorsque ces choses s’accompliront.» Comme il en avait coutume, il prit le pain, le rompit en autant de morceaux qu’il y avait de convives et en distribua les parts. Pensant «le Maître se retire au désert pour échapper aux prêtres du Temple, mais bientôt il reviendra plus fort et, avec l’aide des anges, il restaurera la royauté divine sur la terre d’Israël», Jean de Zébédée demanda «lequel en attendant ton retour deviendra le plus grand d’entre nous ?».Jésus répondit «où que vous alliez, mes enfants, vous vous tournerez vers Jacques le Juste (évangile de Thomas logion 12, église judéo-chrétienne de Jérusalem, dont Jacques fut l’Evêque) Il saura vous rassembler quand on vous persécutera à cause de moi, et vous conduira». Le même soir, il prit la coupe, rendit grâce au Seigneur et dit « buvez ce vin entre vous, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu.» Ils pensèrent que le Maître, comme le Baptiste, venait de prononcer le vœu d’abstinence pour le reste de sa vie.
Guétsémani Le procès
Judas l’Iscariote dit « Maître, tu es las, reste près du torrent, dans l’oliveraie de Guétsémani, où dorment ceux de la Pérée et du Jourdain »André dit «Ce sont des disciples du Baptiste» Quand se relevant de sa prière, il revint vers ses disciples endormis. Judas resté seul éveillé, revint du fond de l’oliveraie vers Jésus, et posant la main sur son épaule, il dit «ne craint pas, Rabbi». Des lévites et serviteurs du Temple armés de bâtons sortirent de l’ombre et se ruèrent. Abandonnant l’Elu de Dieu, tous les disciples s’enfuirent dans la nuit. Judas courait avec eux en poussant des cris.
Kaïphe, gendre d’Hanân, et par lui, Hânan gouvernait encore le Sanhédrin et commandait dans le Temple. Les deux faux témoins dirent «il blasphème le Temple de l’Eternel. Jésus se taisant, ils finirent par se contredire. Hanân, hors de lui, rendit le prisonnier aux gardes. Kaïphe leur commanda de livrer le Galiléen aux Romains, eux seuls pouvaient le faire mourir pour les troubles causés dans le sanctuaire. Les lévites menèrent Jésus chez les païens, dans le palais du préfet Pilate. Ils restèrent à la porte pour ne pas se souiller, Pilate dit «es-tu le roi des juifs ?» Jésus dit «c’est toi qui l’as dit». Il s’écria que seul le divin Tibère César était roi de la Judée et la Samarie. Jésus ne répondait pas.
Dans le jardin de Jonathas Golgotha
A l’aube, aucun des bruits de la nuit n’était monté de Guéthsémani. Bar-Timée dit «Ils ont arrêté le Maître. A Guétsémani ! Ils les ont tous arrêtés ! Pas tous, j’ai vu Pierre s’échapper». Ma mère, plus blanche que la laine, dit «allons là-bas» mais elle trébucha plusieurs fois sur les pierres du chemin en courant derrière moi pour descendre le lit du torrent. A genoux dans la poussière, elle criait «où est Jésus, la lumière de mes yeux ? Délivre mon unique Seigneur, délivre-le !».Quand la procession des condamnés se trouva face à moi dans la ruelle, je vis que le Serviteur de Dieu était nu, vêtu de son sang qui ruisselait, car les soldats l’avaient fouetté jusqu’à l’os. Le raillant, certains lisaient à voix haute la planchette accrochée à son cou «Roi des Juifs». Beaucoup se taisaient. J’étais parvenu dans les premiers rangs du peuple, mais les soldats empêchaient les juifs de monter sur la butte du Golgotha. Ils nous découvraient la honte (nudité totale) de ceux qu’ils exposaient sur le rocher. Je voulus détourner les yeux, mais, en les levant vers son visage, j’accrochais son regard. Ses lèvres remuèrent, il s’efforçait de me parler. Je n’entendais pas ce qu’il disait. Lui, m’aima jusqu’au bout, prononçant les mêmes mots, qu’il espérait graver dans mon esprit. Soudain je pris peur, je craignais qu’il n’attire sur moi l’attention des soldats. Voyant qu’il s’épuisait à dire ce que je ne comprenais pas, je cédai mon rang aux hommes vils qui me bousculaient.
Ce cruel supplice, ma mère le vit. Elle gardait les yeux ouverts, tenant son «unique» au bout de son regard, comme pour l’aider à respirer. Pleurant sans bruit, elle disait «Malheur aux yeux qui voient ainsi les tourments d’un fils…». Alors l’Eternel eut pitié : sa vue se retira de ses yeux, comme la vie se retirait de son âme, et dans cet instant elle devint aveugle ( aucune allusion des évangiles ou apocryphes, il pourrait s’agir d’un ajout)
Troisième livre : de Pâque à Pentecôte
1er martyr Etienne
Mort de Marie
Jacques et Jude se retrouvent Pierre revient vers Jacques, qui réconforte et décide
Les disciples se cachaient dans des citernes, jardins ou celliers, s’attendant à être livrés. Le jour du sabbat, nous ne pouvions marcher vers la Galilée sans transgresser la Loi. J’avais fui dans le haut quartier, nommé «Sion», espérant trouver asile chez les Parfaits. Dans une rue déserte, je retrouvai Jacques assis en haut d’un escalier. Nous gémissions, n’osant prononcer le nom du Maître, car la honte de son supplice était sur nous. «Qui lui donnera une sépulture ? » Les Romains l’avaient descendu de la croix pour ne pas scandaliser le peuple d’Israël dans un jour deux fois saint
(les historiens suggèrent le 7 avril de l’an 30 ou le 3 avril de l’an 33)
Pierre fut le premier des Douze à nous rejoindre. Il dit «qu’on ne m’appelle plus jamais Pierre! Car je m’effrite comme de l’argile ! J’ai renié celui que j’aimais !» Jacques dit «c’est bien le signe que les prédictions de Jésus s’accomplissent, qu’il était un grand prophète» Pierre dit «ton frère n’a pas prophétisé qu’il allait mourir avant la Pâque, sur la croix comme un voleur, un sans-Loi !» et il pleurait. Jacques, depuis qu’il parlait avec Pierre, gagnait en confiance «garde-toi de blasphémer Simon ! Il est écrit Celui qui nous faisait respirer, le Messie de l’Eternel, a été pris dans leurs fosses.Adorons la volonté du Seigneur. Nous rassemblerons le petit troupeau de nos frères dans un lieu sûr et, ensemble, nous attendrons la Fin des temps en priant le Tout-Puissant» Il me demanda de trouver la Magdaléenne, puis Bar-Timée l’Aveugle, qui se rendant en tous lieux, pourra aider à notre salut. Je les retrouvai ainsi que Salomé, Bar-Ptolémaïs, Matthieu, Jacques et Jean. J’appris qu’André et Philippe s’apprêtaient à emmener certains vers la Galilée. Bar-Timée dit «hâtez-vous de partir si vous ne voulez périr!». Mais la Magdaléenne désirait rester pour pleurer Jésus pendant les 7 jours du deuil. Elle avait vu qu’un homme important du Sanhédrin, avait donné de l’argent aux soldats pour faire emporter le corps de Jésus. Après l’avoir lavé, répandu sur lui aloès et aromates, enveloppé d’un linceul, ils l’avaient déposé dans un tombeau neuf, puis avaient roulé la pierre devant la tombe. Elle dit «demain, dès le lever du jour, je descendrai au tombeau avec Salomé.» Jacques décida qu’avec Pierre, les fils de Zébédée et moi, nous ne laisserons pas les femmes seules à Jérusalem.
Jésus n’est plus au tombeau Jésus apparait à Marie de Magdala
Nous n’avions pu retrouver ni Sara, ni notre mère, ni José. Jacques avait appris que Judas s’était pendu, «Honte à nous !» Il ne voulait plus manger son pain (évangile des Hébreux). Je retrouvai Marie de Magdala, chancelante, s’écriant «ils l’ont enlevé et nous ne savons pas où ils l’ont mis !». Le jour d’après, comme elle était retournée seule là-bas, elle revint dans la maison toute tremblante et ne nous parlait plus. Le lendemain, elle me révéla sa rencontre avec Jésus, qui lui dit «Va dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Dis-leur que je les précède en Galilée». Saisie d’effroi, elle ne put rien dire à personne et me demanda de garder le secret. «Je n’ai pas reconnu le Maître mais c’était bien sa voix !». Nous ne pouvions porter la nouvelle à ceux que Jacques et Pierre rassemblaient dans la maison. Tous se seraient moqués d’elle. Je la plaignais car c’était la première fois qu’elle désobéissait à Jésus.
Apparition aux disciples d’Emmaüs,
La nuit tombée, Jean de Zébédée vint à moi. Son visage rayonnait «Le Maitre est vivant ! Il est ressuscité ! » Cléophas nous a tout dit. Avec Yossi Bar-Sabbas, ils étaient en route vers la Galilée, mais ayant des parents à Ephrem, ils préférèrent passer par le chemin des montagnes. A 20 stades (4km) de Jérusalem, un voyageur, le châle sur la tête, les rattrapa et demanda de quoi ils parlaient. Partant de Moïse et de David, il leur expliqua ce qui, dans les Ecritures, concernait la Promesse. Ils arrivèrent près d’un village nommé Les Sources (Emmaüs en araméen). A table, il dit les bénédictions sous son châle. A la fraction du pain, les disciples reconnurent Jésus. Mais lui, se levant, disparut dans la foule. Aussitôt, ils vinrent nous l’annoncer à la salle haute. Je racontai ce que Marie avait vu au tombeau. Il y eut un tonnerre de joie. «Il ne nous a pas abandonnés. Il est ressuscité ! C’était écrit !» (Osée, et le Livre des Jours). Quelques-uns doutaient. Tous se tournèrent vers Jacques qui dit «peut-être que notre sœur Marie et nos deux frères ont-ils vu des anges ?» Cléophas protesta, puis je dis «sa lumière aurait éclairé le vestibule du tombeau, or Marie est restée dans l’obscurité» Pierre dit «retournons dans la Galilée sans plus tarder car la vision de Marie l’a ordonné». Jacques «Prions d’abord. Restons ici 7 jours, jeûnons pour que l’Esprit de l’Eternel, souffle de conseil et d’intelligence, nous pénètre et nous guide.» Il fut fait comme il le voulait. Ma mère vint aussi. Après le supplice de Jésus, Sara l’avait trouvée aveugle et assise dans la poussière du Golgotha. Je l’avais abandonnée. J’implorais son pardon. Avec douceur, elle caressa mon visage et mes cheveux; et dit en souriant «Adorons l’Eternel».
Apparition à 4 disciples au lac de Galilée attente à Jérusalem les yeux de Marie voient la lumière
A la porte de notre chambre haute fermée par crainte, André vint frapper. Il revenait de Galilée pour nous annoncer que Jésus s’était montré à lui, Jacques de Zébédée, Matthieu d’Alphée, Petit-Jacques et Philippe. Cris d’allégresse. Ayant dit à la Magdaléenne «je vous précède en Galilée», il était apparu à nos frères au bord de la mer comme il l’avait annoncé. Mangeant avec les 4, (Jude insiste qu’il ne s’agit ni d’un ange de lumière, ni d’un fantôme), il leur avait dit «je monte à Jérusalem». André pensa que Jésus leur ordonnait d’y attendre son retour dans la gloire du Père. Nous eûmes foi dans cette parole. Plusieurs disciples revinrent vers nous. Mon frère José, reparti à Nazara avec notre âne, me dit «ta femme a accouché d’un fils, circoncis au 8è jour, et l’a nommé Yeshua» Revint Matthieu qui avait reçu un collier d’or d’un caravanier baptisé la veille de la Pâque. Jacques, voyant que nous étions 40 pour prier, le nombre augmentant sans cesse, vendit le collier pour une plus grande maison. Jésus était ressuscité et nombreux étaient ceux auxquels il se montrait. Peu après, je prenais ma mère par la main un jour de sabbat pour la conduire dans la synagogue proche des bains de Siloë (purification). Sa vue revint peu à peu. Elle dit «j’ai retrouvé la lumière ! Glorifions l’Eternel, Il a eu pitié de sa servante, il permet que je revoie mon fils de mes yeux quand il reviendra dans la maison. Elle demanda «quand Jésus est revenu du séjour des morts, avait-il avec lui son frère Simon ?»
Apparition à Jacques Matthias est choisi comme 12è des Douze
Les onze décidèrent de choisir parmi les disciples un «douzième». Pierre voulait un témoin de Jésus depuis son baptême par Jean jusqu’à sa résurrection d’entre les morts. Mon frère Jacques ne pouvait être regardé ainsi, car il ne l’avait rejoint que la dernière année. Il me dit «à moi aussi Jésus est apparu quand je dépérissais à cause de sa mort, la folie de Judas et la fuite des nôtres. Je jurai de ne plus manger mon pain, désirant goûter la mort. Une nuit, je vis une table brillante et un gros pain. Un homme vêtu de blanc rompit le pain, me le donna en disant : «mon frère, mange ton pain, le Fils de l’homme est ressuscité d’entre ceux qui dorment. (évangile des Hébreux; Paul ICo 15,7). Craignant d’avoir été trompé par un rêve, je n’osai rien dire.» Pierre et André présentèrent deux témoins Yossi et Matthias. Tous prièrent. Le sort désigna Matthias. Je dis à Jacques «faisons monter de Galilée nos femmes et enfants, ceux de Jéricho et de Beth-Ania qui aimaient le Serviteur de Dieu et suivent sa Voie, cette maison sera comme l’arche de Noé. Un soir, des femmes se mirent à chanter «Je ne mourrai pas, le Seigneur est avec moi», «j’ouvrirai la bouche et son esprit parlera par moi». D’autres se mirent à prophétiser contre Rome, Jérusalem. L’Esprit jeta par terre l’un des Douze, qui, ayant reçu le don de voir et d’annoncer, vit le Dernier Jour et le châtiment des pécheurs (Pierre et Jean prophétisaient, Actes des Apôtres).
Dans l’attente du Jour du Seigneur Pentecôte
Nous ne formions qu’une seule âme, ne dormions pas, mangions peu car la bourse de Matthieu s’épuisait. Ma mère dit «vendons ce que nous possédons dans notre village». Le 50è jour après la Pâque, 1er jour de la fête des Semaines, il y eut une grande tempête et les ténèbres vinrent. Jacques exhortait «Prenez confiance dans le Seigneur !» Le vent s’engouffra dans la salle, arrachant la porte. La terreur fut sur nous. Entra une boule de feu, des langues, semblables à des flammes, apparurent et se séparant les unes des autres, se posèrent un instant sur chacun. Quand tout fut revenu dans le calme et le silence, nous posions beaucoup de questions autour de nous, aucun ne comprenait ce que disaient les autres, nous parlions tous dans d’autres langues que celles de nos pères.
Pierre témoigne devant la foule Jacques témoigne au Temple
Une multitude de pèlerins accourut «ne sont-ils pas Galiléens ? D’où vient que nous les entendions parler dans les langues d’au moins 12 Nations ?». Pierre éleva la voix pour témoigner : «Fils d’Israël ce qui survient ici est ce qu’avait annoncé le prophète, l’Eternel nous a envoyé le Souffle afin que nous parlions en langues, car il nous charge de porter la nouvelle du Royaume aux enfants d’Abraham qui ne peuvent l’entendre dans la langue de nos pères». Jacques dit : «un feu est allumé. Allons crier sur les parvis que l’Elu du Seigneur est ressuscité et qu’il connaît le chemin de la mort à la vie. Hâtons-nous !» Montant au Temple sans détour, comme un homme qui n’a plus de crainte, il dit : «depuis que les sans-Loi (prudence par rapport au Temple) ont fait mourir Jésus sur le bois, beaucoup parmi nous l’ont vu vivant dans sa chair, le Très-Haut l’a relevé d’entre les morts. Il est vivant ! (par opposition aux dieux «morts» des païens). L’heure du jugement approche. Israélites mes frères, sauvez-vous de la mort !». C’était la 1ère fois que Jacques enseignait. La peur s’emparant des cœurs, 40 Judéens le suivirent depuis le Temple jusqu’à notre maison. Venus des campagnes, des pèlerins couchèrent dans notre rue mais bientôt ils demandèrent à manger.
La communauté s’organise Parler en langues : 1èr différend entre les saints
Tandis que Pierre et Jean exhortaient les Judéens et les pèlerins, Jacques et José acquirent meules à bras et grains. José vendit ses biens pour les pauvres, espérant que Jésus se montre à lui. Quand je n’instruisais pas les postulants que Philippe et André baptisaient, j’aidais Matthieu, qui tenait la table des comptes. Pierre s’emportait «laissez ces deniers qui souillent vos mains et priez !». Lorsqu’il priait et que beaucoup parlaient en langues ou prophétisaient, il tombait lui-même en extase (Transfiguration; Actes des Apôtres 10,9-16 ; 11, 4-16). Tel n’était pas le cas de mon frère Jacques, qui se recueillait mieux dans le silence, disant «je préfère cinq paroles intelligibles à dix mille paroles en langues». Pierre, embarrassé, dit à Jacques «tu n’es pas dans l’erreur quand tu blâmes nos tumultes mais pour le peuple de Judée, le parler en langue est un signe : il donne foi à beaucoup. S’adressant aux douze réunis, Jacques dit avec sévérité «L’Eternel hait toute vaine agitation». Jean, qui prophétisait, se prononça contre la nouvelle règle mais Pierre approuva mon frère, qui demanda que «dans nos assemblées, tout se fasse dans l’ordre et la discipline. On peut convaincre par le Souffle mais aussi avec l’intelligence.»
Les Pauvres de Jérusalem communauté des biens de la qéhila (ekklesia)
Baptisés par l’Esprit et le feu, Jacques, Pierre, Jean et André, chaque jour, exhortaient le peuple : « la Promesse du Royaume est pour vous et vos enfants ! ». A la différence des Parfaits, nous recevions dans notre arche sainte tous les petits d’Israël qui demandaient le baptême au nom de Jésus. Les pharisiens et les sadducéens nous surnommèrent les «nazôréens» ; nous nous donnions pour nom les Pauvres, les ébionim. Quelques hellénistes de la Diaspora décidèrent de nous aider. Le premier fut Joseph, lévite originaire de Chypre, que Pierre surnomma Bar-Nabbas (Barnabé), «fils du réconfort», parce qu’il mit toute sa force à nous secourir. Sitôt baptisé, il enseigna en grec dans les synagogues des Alexandrins. Puis, Shimon, originaire de Cyrène, nous donna le champ d’où il revenait quand les Romains l’avaient chargé du bois de la croix de Jésus. D’autres d’Antioche et d’Ephèse l’imitèrent. Comme les petits de la Galilée, hébreux et hellénistes livrèrent ce qu’ils possédaient sans rien dissimuler.
Soutien des femmes aux veuves Marie attend le retour de Jésus les « trois colonnes »
Les nouveaux baptisés nous cédaient leurs biens mais aussi le fardeau de leurs veuves. Suzanne, Léa et Tabitha s’occupèrent des plus âgées. Sara et des sœurs de la communauté tissaient tuniques, chemises et ceintures que José allait vendre au marché. Ma mère filait la laine. Faible, elle mangeait peu pour laisser le pain aux enfants, mais gardait l’espérance de voir Jésus dans toute sa gloire et toute sa chair. Tous les jours, nous montions au Temple : Jacques, que le peuple de Jérusalem appelait «le Juste», ne se dérobait à aucun précepte de la Loi. Je lui dis «pourquoi prier dans un temple quand chaque juste est un temple vivant élevé à la gloire du Père ?» Il dit «Garde toi de blasphémer ! Jésus aimait prier dans le Temple». Avec Pierre et Jean, ils étaient nos trois colonnes de la voie de Jésus. Les docteurs pharisiens disaient que nous étions dans l’erreur : les justes ressusciteront, mais à la Fin des temps, tous ensemble.
Remontrances des baptistes sur notre baptême
Trois baptistes, tels des nazirs, nous firent de vives remontrances sur notre baptême, différent de celui de Jean Ils disaient «Prenez garde car vous abusez le peuple et vous offensez Dieu !». «Shalom, dit Jacques le Rempart, bien que vous n’ayez pas autorité sur ceux qui suivent la voie de Jésus, voici : il nous suffit d’une petite coupe, ayant été baptisés par le feu du Très-Haut, nous baptisons par l’Esprit en imposant les mains. Quant au Serviteur de Dieu, auquel le Précurseur, votre maître, avait rendu témoignage, nous avons vu et beaucoup d’autres avec nous, qu’il s’est relevé d’entre les morts !». Ils reculèrent devant Jacques et partirent.
Forte présence des Hellénistes ardeur d’Etienne diaconie
Venaient à nous plus d’hellénistes que d’hébreux. Parmi eux, Etienne venu d’Ephèse pour étudier aux pieds des docteurs du Temple; Nicolas, un prosélyte grec circoncis à Antioche; Nicanor un fils d’Abraham venu d’Alexandrie et Philippe, un juif de Damas. Vint un cousin de Bar-Nabbas, surnommé Marc, venu de Chypre avec sa mère pour vivre à Jérusalem où tous deux possédaient dans la ville haute, une grande maison. Etienne était le plus jeune, avec tant de puissance qu’il étonnait le peuple par sa parole. Ce fut le 1er d’entre nous, qui osa, hors de nos murs, proclamer que Jésus était bien le Messie d’Israël, le Fils de David annoncé par les prophètes, «Le Christos (Messie en grec).
Face aux sarcasmes des Anciens, Etienne se mit à prêcher contre ceux du Temple.
Pour le service des tables aux veuves grecques, séparées des autres par les rituels, les Douze proposèrent à Etienne de trouver 7 hommes pour former diaconie. Ces diacres passèrent très vite du service des tables à celui de la parole. Ils prêchaient en grec, sans même attendre l’envoi par les Douze. Pierre et Jacques s’alarmèrent, car ils ne savaient pas ce qu’ils enseignaient. Devenus trop nombreux, les hellénistes proposèrent d’installer leur diaconie, avec disciples et veuves, dans la ville haute, seuls restaient dans la ville basse Bar-Nabbas, Philippe de Damas, et le très jeune Marc.
Diversité des dons et de ministères
Jacques me retira du ministère du baptême car je baptisais les petits enfants morts. J’avais 19 ans et voulais annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Serviteur de Dieu. Il dit «il y a diversité de dons et de ministères. Chacun est nécessaire à tous». Je dis «Pierre a le don d’exhorter, Matthieu de compter, André de Baptiser, Thaddée de prophétiser, José de vendre, toi, l’Elu du Seigneur savait que ta nature te porte à diriger. A quoi suis-je bon, moi le dernier de la lignée ?» Il dit «mon frère, tu es né pour aimer. Apprends à le faire fructifier. Tu possèdes un autre don, qui peut être utile à nos frères. Avec le stylet, tu formes de belles lettres. Etudie, petit, tant que le jour luit».
L’Ecriture s’accomplit
Vint un homme Isaac, rencontré chez les Parfaits du temps où j’étais postulant il y a 4 ans. Se plaisant à contester avec moi, il revint souvent m’apporter du papyrus usé que les Parfaits avaient en abondance, car ceux-ci avaient construits des bibliothèques et y recopiaient l’Ecriture. Il prit pour moi des livres des Prophètes que j’allai dérouler chez lui. Il dit « votre prophète se nommait-il lui-même Mashiah ?» Je dis « Il ne se donnait aucun titre, sauf celui de Fils de l’homme, ben-adam, que l’Eternel donna autrefois à son prophète Ézéchiel». Il dit « Ne sommes-nous pas tous des fils d’Adam ?» Je dis « Etienne dit que cette parole revêt un sens caché
En découvrant les prophéties d’Osée et de Malachie, de Michée et de Zacharie, de Jonas et de Sophonie, les chants de notre roi David, ceux de Salomon, je découvris que tous, rois ou prophètes, avaient parlé de Jésus. N’était-il pas écrit dans Malachie que Jean le Baptiste viendrait le premier «voici, dit l’Eternel, je vous enverrai mon messager et il préparera le chemin». Dans Zacharie, la mort était annoncée : les habitants de Jérusalem pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Dans les psaumes de David, je retrouvais chacun de ses tourments : ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Plus loin, je lisais sa résurrection et le baptême de feu que nous avions reçu de Dieu : Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs.Daniel, enfin, me dévoila le mystère du Fils de l’homme : sur les nuées des cieux il arrivera quelqu’un de semblable à un fils d l’homme, il s’avancera vers l’Ancien des jours et sa domination sera éternelle. Ces choses cachées, je voulus les copier en un seul petit rouleau de livre, les publier pour les enseigner à nos frères et confondre nos ennemis. Je ne pus achever mon ouvrage, car, ayant appris que Jacques montait tous les jours au Temple, et que souvent je l’accompagnais, Isaac, en colère, me chassa, me traitant de Fils des Ténèbres au cœur double.
Mort d’Etienne Persécution et dispersion
Un soir, Etienne s’en prit aux sacrificateurs hérodiens et à tous les Judéens. De jeunes pharisiens l’emmenèrent hors de la ville, déposant leurs manteaux aux pieds d’un des leurs, le lapidèrent. Le malheureux priait «Seigneur, reçois mon esprit». Commença une grande persécution contre les nazôréens et ceux qui avaient reçu le baptême du Messie Jésus. Jacques dit «nos frères hellénistes ne peuvent rester, la famine irrite le peuple et le porte aux extrémités. Aussi doivent-ils descendre dans la Samarie et les villes grecques de la côte. Quant à nos hébreux, qu’ils se sauvent de tout mal en allant prêcher la Bonne Nouvelle aux fils d’Abraham qui sont au-delà du Jourdain». Tous durent se disperser.
Reprise en main miracle de Pierre et Jean
Jacques mit de l’ordre dans notre qéhila : Pierre et Jean seraient les seuls à porter la Parole dans la ville. Il advint qu’au Temple, ils guérirent un boiteux qui mendiait. Les Anciens du Sanhédrin, remplis de fiel et de jalousie, furent fâchés. Mais toute la ville connut le miracle. Par la prière et l’autorité, nos «colonnes» chassaient les démons des possédés sans prendre d’argent. Marie de Magdala guérissait les paralytiques en leur donnant du pain d’orge, car depuis la disette, la plupart avalait herbes mauvaises ou coloquintes sauvages qui les empoisonnaient.
Mort de Marie
Quand j’eus 20 ans, Tabitha enfanta notre 2è fils. Il fut circoncis au 8è jour et je l’appelais Daniel, du nom du prophète qui avait annoncé la venue du Fils de l’homme. Vers le même temps, la mort s’approcha de ma mère. Elle avait attendu le retour de son fils bien-aimé disant avec tristesse «pourquoi ne se montre-t-il pas à moi? Est-il irrité parce qu’au commencement de sa mission, j’ai cru qu’il agissait comme un insensé? Ou c’est l’Eternel qui lui défend de se montrer ?» Quand tous furent réunis autour d’elle, elle dit «me voici au milieu de vous tous comme une vigne fertile…» Au comble de la souffrance, elle s’écria «Hâte-toi Seigneur d’accomplir ta volonté dans ta servante !».
Elle s’apaisa en reconnaissant ma voix et dit «j’ai perdu la lumière… si mon fils apparaît, je ne saurais pas qu’il est là» Je lui dis «soit sans inquiétude, mère, il te parlera » Jacques dit «Tu ne dormiras qu’un instant, mère, et quand tu rouvriras les yeux, nous serons tous déjà avec toi dans la félicité du Royaume». Beaucoup vinrent à la porte de la chambre. Nos Pauvres aimaient Marie comme une mère compatissante à tous les petits d’Israël, et en même temps ils la révéraient comme la mère juste et sainte d’un seul. Cependant elle était dans une détresse semblable à une femme en couches dominée par l’angoisse. Enfin dans un long soupir, son âme se détacha. Cachant ses larmes, Jacques dit d’une voix raffermie «en vérité, nous le savons, ce n’est pas une mort que la mort de notre mère, c’est une vie éternelle.»
(apocryphes : l’Assomption de Marie et l’histoire de Joseph le Charpentier. Les auteurs avaient-ils lu la vie de Jude ?)
Quatrième Livre
Missions dans les nations
Paul
Faux-prophète et massacre Envoi en mission
Après 4 années d’exhortations, missions, et baptêmes, nous étions environ 4000 dans la ville. Se conformant à la Loi, chacun vivait du travail de ses mains et restait dans sa maison. Dans la maison de Jacques et de quelques Anciens, les malades continuaient d’affluer ainsi que des hellénistes en fuite. Notre pays restait dans les troubles, un faux-prophèteprovoqua une rixe entre Samaritains et Judéens à propos d’un trésor enfoui par Moïse. Les soldats de Pilate firent un massacre général (Flavius Joseph). Les hellénistes prêchant dans les synagogues de la Diaspora, écrivirent que des craignant-Dieu de plus en plus nombreux venaient à eux; des Samaritains se convertissaient à Sébasté. Jacques envoya, dans les villes grecques de Palestine et de Syrie, des épiscopes (inspecteurs) choisis parmi nos Douze et nos Anciens afin de veiller sur la Parole. Il n’envoya personne dans la ville d’Alexandrie, car les Grecs y massacraient les fils d’Abraham. Je fis établir pour nos épiscopes les copies des prophéties que j’avais rassemblées chez l’essénien. Ainsi la vérité se répandait-elle partout, et elle confondait nos ennemis.
Découverte de la fin du rouleau d’Isaïe
On nous opposait que le vrai Messie d’Israël devait triompher des Nations, que nulle part il était écrit que le Messie périrait sur le bois. Ces incrédules disaient «en quoi sa mort servait-elle le dessein du Très-Haut ? Où est notre délivrance ?» Nous nous taisions. Je vis en songe le rouleau d’Isaïe, rapporté de notre village. Chez le scribe de la ville, je vis que notre livre était plus court que le sien. Dans la suite de la prophétie, Isaïe parlait de Jésus souffrant, méprisé et abandonné des hommes. Il disait : ce sont nos souffrances qu’il a portées, nos douleurs dont il s’est chargé, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu avait enfin levé mes doutes et mis fin à mon deuil. Il a été compté parmi les criminels, lui qui portait le péché des multitudes et intercédait pour les criminels. Les docteurs de la Loi qui nous raillaient, connaissaient la prophétie et nous l’avaient cachée ! Ils savaient que Jésus était le Messie promis, qu’il fallait qu’il fût mis à mort pour délivrer Israël de ses péchés et nous rendre l’amour du Seigneur et son royaume. De ce jour, dans toutes les lettres que Jacques envoya aux apôtres, je mis le témoignage de notre prophète Isaïe afin que nul ne gardât le silence devant les incrédules, les railleurs et les arrogants.
Saül
Pierre et Jean rentrés de leur mission au-delà du Jourdain, vint Saül, un jeune homme petit, noir comme un égyptien, qui demandait à faire leur connaissance, ainsi que celle de Jacques le Juste. Il dit «je suis de la tribu de Benjamin, je viens de Damas où l’un de vos adeptes m’a baptisé. Je me suis retiré 3 années dans le désert pour prier et méditer.» Revenant à Damas, pour prêcher dans les synagogues, il trouva la ville en grande émotion. En effet, suite à la victoire du roi des Arabes sur Hérode Antipas, des légions romaines montaient pour l’assiéger, et le peuple s’en prenait aux romains. Or Saül était aussi citoyen romain. «J’ai donc fui Damas pour Jérusalem. J’ai rencontré Bar-Nabbas qui m’a dit où prient les disciples du Messie.» Je le menais à Pierre, dont il espérait une lettre pour porter la Parole à nos frères des synagogues d’Asie, car né à Tarse, dans la Cilicie, il prétendait connaître tous les Juifs de la côte. Pierre le renvoya vers Jacques : ils ne désignaient aucun émissaire sans s’être concertés. Saül me dit : sais-tu que je fus instruit dans la Loi aux pieds du rabbi Gamaliel, le plus fameux de tous les maîtres. J’étais plus avancé dans les traditions de nos pères que la plupart des hellénistes de mon âge.» Il ne regarda pas le petit livre que j’avais fait pour nos apôtres «je sais ces choses, car je connais toute l’Ecriture. Si j’avais été avec toi plus tôt, tu n’aurais pas été autant d’années sans connaître les desseins cachés du Très-Haut!» Il avait eu une vision de Jésus et d’autres révélations dans le désert. Le Père céleste et Jésus, son Messie, lui demandaient maintenant d’enseigner aux brebis perdues de la Dispersion et aux craignant-Dieu des Nations. Le jour du sabbat, nous partagions le repas du Messie, que les hellénistes appelaient agape. Pierre rompait les pains dans les corbeilles, bénissait le vin de la coupe et l’eau des cruches car nous étions trop nombreux et pauvres pour boire tous à la coupe sainte. (Pères de l’Eglise en témoignent). Pierre, Jacques ou Jean rappelaient que Jésus nous avait commandé d’accomplir ces œuvres en mémoire de lui, et tous, dans le silence et le recueillement, nous sentions que l’aimé de Dieu revenait parmi nous. Or un helléniste, ami d’Etienne, désigna Saül «cet homme est un démon ! Tu étais avec ceux qui lapidaient notre frère Étienne et gardais leurs vêtements! A la tête de ces maudits, tu as ravagé nos maisons et mettais en prison jusqu’aux veuves et orphelins !». Tous les hellénistes cherchèrent à lui ôter la vie. Si Pierre et Bar-Nabbas ne s’étaient jetés devant pour lui servir de bouclier, l’imposteur aurait été tué. Saül reconnut qu’il avait persécuté les «Juifs de Jésus», qu’il s’était converti depuis que Jésus s’était montré à lui sur la route de Damas. Au disciple qui l’avait baptisé, il n’avait rien caché, puis sur son avis, était allé plusieurs années au désert pour nettoyer son âme. Il dit «moi aussi, avec Jésus, comme Jésus, je suis allé de la mort à la vie. Faites-moi une place dans vos cœurs». Plein d’embarras, Jacques et Pierre s’en remirent au conseil des Anciens. Jacques me dit «avec Marc, faites-le partir pour Tarse sans que nos hellénistes l’apprennent. Si nous n’affermissons pas notre autorité sur l’esprit de ces jeunes gens, ils seront la cause de notre perte!» Instruit malgré sa folie, Saül, en toutes choses, n’écoutait que lui-même. Je lui proposais de connaître ce que mon frère le Messie avait dit et fait. Il dit «sa vie dans ce monde ne m’importe pas. Il me suffit de savoir qu’il est mort et ressuscité ». Au port, je payai son passage jusqu’à Antioche, et ne pus rien lui donner pour le pain. Il dit «Aucun apôtre ne sera oublié devant Dieu, ne le sais-tu pas ?». Je n’osai lui rappeler que ce titre n’était pas pour lui, car les Douze ne lui avait donné ni mission, ni mandat. Voyant le navire disparaître, Marc dit «voilà un homme que son savoir, ses visions, et son orgueil font déraisonner. Soyons en paix, nous n’entendrons plus parler de lui»
Pierre envoie Marc à Cyrène, accompagné de Jude
Tabitha enfanta ma fille Miryam, puis mon fils Elie. Pour soutenir les frères dans la Cyrénaïque, Pierre envoya Marc qui parlait le grec depuis l’enfance. Marc me choisit pour l’accompagner, au grand étonnement des Anciens, qui me trouvaient bien jeune. Il dit «Jude a l’âme droite, le cœur fidèle, connaît l’Ecriture mieux qu’un docteur et son œil ne craint pas nos ennemis. Il saura prêcher les Libyens». A Cyrène, grande et belle, nous étions bien accueillis dans les maisons juives : les Israélites haïssaient les Césars de Rome, depuis que ceux-ci les avaient privés des droits dont ils jouissaient depuis le règne des rois d’Egypte. Ils ignoraient que les Grands Prêtres de Jérusalem se détournaient de l’Eternel pour servir le Mammon et la grande «Babylone» (Rome). Nous rencontrions des pharisiens qui, frappés à la lecture des témoignages des prophètes, demandèrent «S’il est vrai que votre Messie reviendra parmi nous pour le Jour de Dieu, quand donc ce jour adviendra-t-il ?». Je répondis par une citation du Livre de Daniel. De plusieurs possédés, Marc fit sortir des esprits malins, baptisa un riche pharisien et plusieurs prosélytes. Mais il ne baptisa aucun des craignant-Dieu, non circoncis. Me souvenant de Tabitha, je fus ému pour ces grecs qui, comme elle autrefois, restaient sur le seuil. Je lui dis «Jésus les guérissait, les touchait et se laissaient suivre par certains. Pourquoi refuses-tu de leur imposer les mains?». Il dit «j’obéis à la loi de Moïse et aux Douze.» L’année durant, nous étions joyeux, car il n’y avait en eux ni débauche, ni impureté. Nos frères de Jérusalem nous accueillirent avec joie, car ils connaissaient le succès de notre mission par nos lettres. Je retrouvai Tabitha avec délice et lui promis de rester avec elle.
Refus de statues grecques dans le Temple de Jérusalem Famine
Jérusalem était dans les troubles à cause de Caius (Caligula), le nouveau César. Il avait ordonné de mettre ses statues dans le Temple ainsi qu’à l’entrée des synagogues dans les Nations. Or aucune figure d’homme ne devait y figurer ! D’où séditions et massacres à Alexandrie et à Antioche où notre frère Bar-Nabbas était allé comme épiscope.
Vint la famine (Actes des apôtres, entre 46 et 48) qui suivit le sabbat de la terre, plus terrible que jamais. Vers notre maison, accoururent veuves, mendiants et errants. Beaucoup mouraient de faim. Jacques et les Douze s’étaient dépouillés de leurs derniers vêtements et marchaient nu-pieds. Se faisant nazir, pour le temps où nous ne pourrions nourrir les affamés, Jacques laissa pousser sa barbe et ses cheveux. Il monta dans le Temple trois fois par jour, priant pour ces indigents dont il lavait les pieds et bandait les plaies. Ses genoux commencèrent à enfler; de son ancienne blessure à la jambe. Il supportait sa douleur et les quolibets des zélotes qui l’appelaient «Genoux de chameau» (surnom attesté par Eusèbe de Césarée) pensant qu’il s’agenouillait trop souvent devant les prêtres.
Retour de Saül à Jérusalem
Nos frères d’Antioche firent alors parvenir une collecte à nos Anciens par Bar-Nabbas, que nous n’avions plus revu. A notre surprise, le cousin de Marc était accompagné de ce Saül mis sur le bateau 3 ans plus tôt. A Pierre et Jacques, il dit «c’est un grand pécheur, mais son repentir est sincère : n’est-ce pas pour les brebis que le Messie Jésus est venu ?
Saül lui dit comment, au Temple, en extase, il avait vu Jésus-Messie qui lui avait ordonné de porter témoignage auloin, vers les Nations et qu’il voulait devenir son apôtre. Jacques s’écria «Apôtre ? Cet imposteur! Pourquoi pas son frère aussi ?» «Mais il l’est déjà» dit Pierre. Confus, Jacques sut qu’il méconnaissait l’enseignement de Jésus. Les Anciens autorisèrent Marc à garder Saül pour compagnon s’il parvenait à l’instruire. Ils lui demandèrent de l’écarter des pharisiens, zélotes et sadducéens, de ne pas le laisser prêcher seul et de ne jamais consentir à ce qu’il prît le nom d’apôtre. Saül n’entra pas dans notre maison, craignant maintenant nos «colonnes» autant que nos hellénistes. Voyant sa brulante impatience, je lui dis «frère, mets un frein à ta bouche et crains les faux témoins! Sinon ce sont encore les nazôréens que viendront tuer les séditieux abusés par les grands».
Mort de Jacques de Zébédée Arrestation de Pierre Fuite de Jean de Zébédée, puis de Pierre
Comme autrefois, le départ de ce grand parleur me délivra d’une crainte et d’un poids. En ces temps de famine et de colère, n’importe lequel d’entre nous pouvait être accusé. D’abord Jacques de Zébédée, pour avoir élevé la voix contre le Temple et Jérusalem. Il fut condamné par le nouveau roi Hérode Agrippa à mourir par l’épée (Actes 12, 2) comme Jean le Baptiste. Puis les Romains crucifièrent deux zélotes galiléens, dont le père avait autrefois mené la révolte contre le recensement de César dans le temps où Jésus n’était qu’un enfant. Le roi Agrippa fit aussi arrêter Pierre. Il l’enferma dans la prison au moment où sur nos instances, Jean de Zébédée s’enfuyait. Le roi avait résolu de faire comparaître Pierre après la fête de la Pâque pour le mettre à mort. Pierre s’enfuit de la prison, guidé par l’ange du Seigneur, et nous dit de l’annoncer à Jacques. Aussitôt, il repartit craignant d’être recherché par les soldats.
Face à la menace, fuite des disciples Jacques garde la maison
Des trois «colonnes» de la communauté de Jérusalem ne restait en Judée que mon frère Jacques, qui me dit «Nous, frères de chair du Messie, sommes maintenant ceux que le roi Hérode, le Grand Prêtre ou le peuple de Jérusalem persécuteront le plus volontiers». Je dis «pourquoi les hérodiens ne s’en prennent-ils jamais aux Fils de Lumière qui les haïssent au point de demander à Dieu de les détruire jusqu’au dernier ?» Jacques me dit «parce que les Parfaits ne sortent jamais de chez eux, ne font pas d’exhortations sur les parvis, ni de conversions dans les synagogues. Notre frère José et sa femme Léa iront à Tyr. Toi, tu rejoindras Marc et Bar-Nabbas qui enseignent dans l’île de Chypre. Prêche tous les fils d’Israël jusqu’aux confins de l’Océan. Je garderai la maison. J’emmenai donc Tabitha et notre fils Yeshua qui avait environ 10 ans.
Saül se fait appelé Paul à Cyrène, Jude s’oppose aux riches de la synagogue
Nos frères de la Diaspora avaient des entrepôts dans tous les ports pour commercer. A Salamis, je retrouvai Marc et Bar-Nabbas, dont les parents, lévites fort considérés, possédaient de grands biens dans cette ville et donnaient de l’ouvrage à beaucoup d’enfants d’Israël. Mais peu d’entre eux suivait la voie de Jésus, malgré leurs exhortations. De l’autre côté de l’île, à Paphos, où Sergius Paulus, proconsul des Romains (Actes des Apôtres) se plaisant à recevoir dans son palais charlatans et magiciens, fit venir Saül qui avait exorcisé un possédé. Voyant avec satisfaction que celui-ci dénonçait habilement les fraudes des imposteurs, il en fit son favori. Paulus devint le protecteur de Saül, lequel selon la coutume des païens, ajouta à son nom celui de son protecteur et se fit appeler Paul.
Face à la vive opposition des pharisiens et hérodiens, Marc, Paul et Bar-Nabbas retournèrent à Antioche. Marc portait les livres sacrés et mon recueil de prophéties. Avec Tabitha et Yeshua, je repartis à Cyrène, 5 ans après l’avoir quittée.
Chaque jour, je croisais les principaux de notre diaspora, qui vivaient encore en paix avec les Grecs jaloux (les juifs dispensés de l’impôt (impôt du Temple) et des obligations militaires (sabbat et interdits alimentaires). Mais ces riches marchands frustraient nos indigents, les payant avec retard, et prêtant avec usure. Et je les exhortai durement. Le chef de la synagogue fut irrité quand je dis «hommes d’Israël, donnez aux pauvres de notre peuple, mais aussi aux plus pauvres des Grecs, car tous les petits sont égaux dans le malheur aux yeux du Messie Jésus». Ils plaidèrent contre moi. Les Anciens n’osaient me chasser de leur synagogue, car j’avais mis mon fils Yeshua à étudier la Loi auprès du hazzanet cet homme instruit trouvait l’enfant plein de grâce et de promesses. Je songeai à l’exécution de Jacques de Zébédée, la lapidation de l’apôtre Philippe, l’arrestation de Pierre, la fuite de Jean, au silence d’André, à la mort de la Magdaléenne et du vieux Bar-Timée, apprises par la lettre de Jacques. Bientôt plus aucun de nous ne sera là pour rappeler les paroles de Jésus.
Ne savions-nous pas, par Jésus lui-même, que le dernier des apôtres ne s’endormirait pas avant son retour ?
Jude s’occupe des pauvres A Tyr, José convertit artisans et marchands
Tabitha mit au monde une fille, que je nommai Ruth. S’élargissait sans cesse notre communauté de Pauvres, qui venaient autant du faubourg grec que du quartier juif. Non circoncis, les Grecs ne pouvaient être des nôtres. Quant aux nomades éthiopiens et aux esclaves nigrites, je lavais leurs plaies au vin aigre, sans oser les baptiser, faute de pouvoir les instruire. Avant la 3è année, Jacques m’ordonna de rejoindre Antioche. Je fis escale à Tyr où mon frère José avait converti beaucoup d’artisans et de marchands. Le César de Rome(Claude) nomma préfet Crespius Fadus. Dans la Pérée, vint un pseudo prophète nommé Theudas, promettant à des centaines de pauvres gens une terre et une nourriture abondante de l’autre côté du Jourdain. Fadus les fit tuer. Je pleurai avec José les malheurs d’Israël.
Jude à Antioche les juifs n’acceptent pas les incirconcis à leur agape Jude à Jérusalem
Nos frères d’Antioche, que les Grecs appellent christianoï, soit «messianistes», vinrent à ma rencontre. Bar-Nabbas, Marc et Paul prêts à partir en mission, Paul pétillait comme une étoile. Marc soupira «Paul est la plaie que le Seigneur m’envoie, mais qu’il soit fait selon la volonté du Père» Je les remplaçai au mieux. Ces prosélytes ou grecs incirconcislisaient l’Ecriture avec nous et craignaient Dieu, mais il ne leur fut pas permis de partager notre agape. Leurs femmes aimaient entendre la Parole, faisaient de bonnes œuvres au nom du Messie, nous les baptisions, mais le soir du sabbat, nous ne pouvions manger avec elles, ignorant dans quels plats et avec quelles viandes elles préparaient les mets. Elles mangeaient à des tables séparées afin de ne pas violer la Loi. Pierre arriva de la Judée où il était rentré après la mort du roi Agrippa. Je lui demandai quelles paroles Jésus lui avaient dites autrefois. Il redonnait chaque parole avec fidélité sans oser changer la place d’un seul mot. J’eus le désir d’écrire les «dits» du Messie comme un scribe écrit sous la dictée de son maître. Je voulais le faire avec Pierre mais aussi avec tous les témoins qui n’étaient pas encore endormis dans le Seigneur. Pierre me dit «nul n’aura l’usage des signes que tu traces puisque Jésus nous parlera face à face». Il m’ordonna «exhorte cette génération égarée et jette au feu toutes ces bibliothèques ! » Et il chanta avec moi Maranatha. Maintenant que Pierre veillait en épiscope, sur la doctrine de l’ekklesia d’Antioche, je revins à Jérusalem avec ma femme et mes enfants. Sur le seuil de la maison, Sara à qui nous avions confié trois de nos enfants, n’osait dire que notre fils Elie âgé de 10 ans était mort et que notre fille Miryam était gravement malade. Le 3è jour, malgré nos prières, l’enfant mourut. Me souvenant que Jésus disait «dès ce temps-ci, le Père nous rendra au centuple les bien-aimés que nous aurons perdus», j’allai auprès de Tabitha. Elle conçut et enfanta un fils auquel je donnai le nom de Joël. Nous eûmes 4 beaux enfants pour chanter la gloire du Seigneur : Yeshua, Daniel, Ruth et Joël.
Paul : Jésus Sauveur Paul et les non circoncis
De retour à Jérusalem, Marc dit à Jacques «ayant débarqué pour apporter la Bonne Nouvelle aux Juifs de Pergué, Paul se présenta comme l’apôtre de Jésus, son dernier apôtre». Irrité, Marc lui dit «Même Jude, frère de Jésus ne prétend pas être un apôtre. Toi, Paul de Tarse, tu n’es qu’un émissaire chargé par l’ekklesia d’Antioche d’aider notre Bar-Nabbas. Une belle élévation pour celui qui fut grand persécuteur de nos frères !» Mais Paul ne ployait jamais la nuque. «Jésus-Messie m’a lavé, délivré, fortifié puis m’a lui-même envoyé porter le témoignage de son amour à tous les hommes dans tous les lieux habités.» Jacques reprit «Que dit-il du Messie Jésus ?». Marc dit «Il l’appelle «Sauveur», il dit Dieu l’a ressuscité des morts car il est plus grand que les rois et les prophètes, plus grand que toute la postérité de David ! Même le Baptiste, même Elie, même Moïse ne sont pas dignes de délier ses sandales ! Alors les notables nous injurièrent pour avoir profané le nom de Moïse, et la synagogue fut bientôt dans une grande agitation» Paul voulut aller jusque dans les montagnes d’Anatolie. Marc refusa de le suivre. Bar-Nabbas décida de s’enfoncer dans les contrées barbares pour y assister son assistant. Mon frère fut saisi d’angoisse «ce Tarsiote me fait trembler, d’où vient que Bar-Nabbas supporte cet insensé ?» Je lui dis «cela vient de ce que notre bien-aimé lui-même préférait, aux sages de ce monde, les voyants et les cœurs exaltés. Peut-être Paul est-il sage à la manière de Dieu ?»
Deux ans après, Paul vint seul porter à Jérusalem le fruit d’une nouvelle collecte de l’ekklesia d’Antioche. (En 47ou 48 nouvelle année sabbatique). Il se glorifiait d’avoir le soutien de l’Eternel et de Jésus-Messie pour sa prédication chez les barbares de Pisidie. On l’avait lapidé et laissé pour mort, mais «au moins, disait-il, je n’y ai pas reçu les 39 coups, car là-bas il n’y a pas de synagogues !» (fouet infligé aux perturbateurs par les chefs des synagogues) Je lui dis «s’il n’y a pas de juifs, qui a circoncis tes convertis ? Ne doivent-ils pas respecter la loi de Moïse ?». Il dit «il suffit qu’ils aimentJésus-Messie». Je fus d’abord transporté de joie, puis saisi d’effroi. Il allait scandaliser nos frères zélés pour la Loi et provoquer la colère de Dieu. Paul espérait recevoir une mission pour la Pisidie, la Cappadoce et la Galatie. La communauté d’Antioche ne lui donna ni lettre, ni compagnon. Il me demanda de le suivre en Galatie Je lui dis «aucun émissaire de la Voie ne peut appartenir à deux communautés à la fois.» Paul renonça à mon aide «toujours à t’inquiéter des règles et des préceptes ! J’irai seul à la grâce du Seigneur ! Me voilà libre ! Moi, Paul je n’aurai plus de limites que celles fixées par Dieu !» et il s’en alla, non sans m’avoir longuement serré dans ses bras.
Danger des faux apôtres Jude rassemble les « loggia » de Jésus accueil des non circoncis
Je mariai mon fils Daniel, de 15 ans, avec la fille de mon frère Simon. Sara, la femme de Jacques, mourut avant d’être vieille. Il ne se remaria pas, redoubla d’austérité, ne mangeant plus rien qui eût une vie (les Pères de l’Eglise indiquent qu’il fut végétarien) et incita chacun à la chasteté. Il priait debout, ne pouvant fléchir les genoux. Tabitha gouverna la maison des Pauvres de Jérusalem, aidée de la femme de Daniel. Jacques m’envoya soutenir notre qéhila de Césarée, où s’étaient réfugiés des juifs, chassés de Rome par le César Claudius (en 49-50, ces juifs créaient des troubles à l’instigation d’un certain Chrestos). A cause de ces loups déguisés en bergers, ils avaient combattu au sein des synagogues, pour défendre ou condamner une doctrine qui ne fut jamais la nôtre et infecta toute leur communauté. Je voyais disparaître la génération à qui Jésus avait promis le Royaume. J’étais dans la détresse comme nos pères dans la traversée du désert en Égypte. Les années ont passé, je dis «les hommes restent dans le péché et ils ne sont pas jugés; ils meurent et ne sont pas ressuscités». Jacques me dit : «Jésus ne nous a pas trompé: c’est nous qui n’avons pas compris que, par les mots «Puissance» et «Règne de Dieu», il signifiait la résurrection de sa chair et non le Jour du Seigneur. Il faut nous préparer à une longue nuit. Gardons-nos lampes allumées.» Désespéré, je m’écriai «pourquoi mon bien-aimé ne s’est-il pas montré à moi ?» Jacques me dit avec sévérité «quitte cet esprit d’envie ! N’est-ce pas devant toi que Jésus a dit les derniers seront les premiers ?» En attendant ce Jour béni, tu seras mon scriptor. Je t’ordonne d’écrire toutes les paroles de Jésus dont tu te souviens et surtout celles que tu as oubliées: nous en donnerons la collection à nos missionnaires. Comment porteraient-ils la Parole s’ils ne la connaissent pas ?»
Je commençai à rassembler les paroles du Messie, ou logia selon les grecs. Pierre n’osa plus m’en empêcher puisque j’obéissais à Jacques. Il répondit à mes questions, et tous ceux qui avaient été, comme lui, des témoins du Messie. Ces logia, je les écrivis simplement, sans ordre, commençant par ce que j’avais entendu, poursuivant avec ce que je découvrais du témoignage des autres. Je n’y mis ni les lieux ni les temps. Quant aux paroles voilées et aux paraboles, je ne donnai pas leur signification. Car Jésus préférait nous laisser découvrir sa pensée. Sur chaque ligne, j’écrivais : «Jésus a dit» et la parole suivait. (recueils de logia avant les récits évangéliques. voir l’Evangile de Thomas, découvert en 1945, la «Source Q», commune à Matthieu et Luc; voir la version copte de l’Evangile de Thomas). Les 70 logia de l’Elu du Seigneur étaient désormais le moyen de calmer les impatiences et de faire taire les calomnies de nos ennemis dans les synagogues. De toutes les paroles du Messie Jésus, l’une manquait toujours : celle qu’il m’avait dite lorsqu’il se tenait debout, nu et sanglant, devant le poteau de sa croix. Je l’avais abandonné. N’étais-je pas le plus indigne des disciples ? Jacques seul était le bon berger juste et fidèle. Il referma plus étroitement la main sur les qéhilasde Jérusalem, de Galilée, ainsi que sur l’Eglise de Césarée et celle de Pella au-delà du Jourdain. Nos frères d’Antioche, unis sous la houlette de Pierre, écrivaient pour demander conseils et exhortations. Jacques et Pierre demandèrent d’accueillir dans les assemblées les Grecs non circoncis, de les baptiser, mais de ne pas entrer dans leurs maisons ni de manger avec eux tant qu’ils ne respectaient pas tous les préceptes de la Loi.
Témérité de Paul juifs et païens à la même table Concile de Jérusalem
Paul reçut 2 fois le fouet en Macédoine, subit les moqueries à Athènes, et fut emmené au tribunal du proconsul par les juifs de Corinthe pour troubles causés dans la synagogue. Fuyant Corinthe, de retour à Antioche, il fut interpellé sur sa mission. Il se félicita de centaines de conversions. Profitant de l’absence de Pierre, il accusa ses dénonciateurs d’ignorer la Parole du Serviteur de Dieu «je m’étonne que vous contraigniez nos frères incirconcis à célébrer l’agape à des tables séparées. Ne sommes-nous pas tous frères en Christ ?» Quand Pierre revint, il trouva tous les baptisés à la même table, juifs et païens. N’osant protester, il mangea avec eux. Paul se dressa contre Pierre avec véhémence «toi qui as mangé et vécu à la grecque, comment peux-tu contraindre nos grecs à Judaïser ?» Une assemblée réunit la qéhilaautour de nos trois «colonnes» car Jean était rentré dans la ville depuis la mort du roi. Paul avait perdu de sa superbe : il était plus facile de prêcher les sauvages Galates que notre saint Conseil où, depuis 20 ans, étaient entrés des pharisiens très instruits que Jacques avait convertis. Mais c’est avec fougue qu’il disait comment le Seigneur ouvrait aux païens la porte de la foi. Irrités, des pharisiens exigèrent l’observation de la Loi de Moïse. Jean les appuya avec vigueur «quiconque va trop avant et ne demeure pas dans la doctrine du Messie Jésus est notre ennemi !». Paul leur résista. Traitant ses adversaires de «faux-frères», il dit «mes frères, j’étais mort, étouffé par mes péchés, mais Christ m’a ressuscité ! ». La discussion commençait à s’enflammer, Pierre voulut éteindre le feu «Dieu qui connaît les cœurs a parfois rendu témoignage à des païens en leur donnant le Saint-Esprit. Je l’ai vu en Syrie. Pourquoi démentir le choix du Seigneur en imposant à ces païens un joug que nous-mêmes avons de la peine à porter ? L’assemblée cria car elle était divisée. Jacques affermit sa voix : «je décrète qu’on ne doit pas créer de difficultés excessives aux païens qui se convertissent en même temps à Dieu tout-puissant et à la voie de Jésus. Pour la nourriture, qu’ils s’abstiennent seulement des viandes sacrifiées aux faux dieux et du sang. Qu’ils ne contractent pas d’unions incestueuses ou adultères au regard de notre Loi. Ainsi pourrons-nous, sans trembler, partager avec eux les tables, le pain, et l’agape. Tous approuvèrent.(Concile de Jérusalem, Actes 15,4-33 et Epître aux Galates 2,1-10). Paul me dit «Me voilà consacré par votre assemblée apôtre des païens comme Pierre l’est des circoncis ! Comme ceux de ta famille, tu restes dans la soumission à la Loi et la crainte du Dieu d’Abraham. Tu n’as pas reçu cet esprit d’adoption par lequel nous crions : Abba, Père ! Viens avec moi et je t’enseignerai mes voies en Christ (1, Co 4,17 ; Paul avait créé une voie dans la Voie, une « secte » en marge de la « secte » judéo-chrétienne). Alors tu sauras que nous ne sommes plus les fils d’Israël mais les enfants de Dieu, tous frères de son Fils premier-né». Il repartit à Césarée pour regagner Antioche avec Tite et Timothée, ses convertis grecs les plus dévoués. Il mit mon petit livret de logia dans sa besace. En retournant à Antioche dans les pas de Pierre, il espérait être recommandé par son ekklesia pour une nouvelle mission en Asie. Cet espoir fut déçu. Cependant, ne voulant pas obéir à Pierre, il partit sans lettres, ni argent. Pourtant Christ n’a-t-il pas ordonné, à ceux qui annoncent la Parole, de vivre de la Parole (rare cas où Paul se réfère à une parole de Jésus, 1Co 9,14). Pendant longtemps, nos communautés ne surent plus rien d’eux.
Cinquième Livre
Joug de Rome Guerre des Juifs Bonne Nouvelle de Marc
Humiliations et outrages au peuple de Jérusalem départ de Pierre, Jean, et des fils de Jude
Sous le joug de « Babymone », les foules de Jérusalem étaient rassasiées d’outrages, même aux jours les plus sacrés. Des soldats les provoquaient par des atteintes à la pudeur, la destruction de livres de Moïse en proférant des insultes. Ils géraient les conflits entre samaritains et judéens, les crucifiant ou les envoyant prisonniers à Rome sans distinction. Indigné, notre peuple disait «il ne faut plus demander justice aux tribunaux des Nations».
Famine et ravages, brigandage et pillages, crucifixions, lapidations, assassinats, incendies, massacres : sur la terre de la Promesse, nous souffrions mille morts que nos frères de la Diaspora ignoraient. Pour nous, Pauvres de Jérusalem, la douleur était d’autant plus vive, que les patriotes (les zélotes), dont certains avaient été compagnons de Jésus et amis de José, nous accusaient d’être du parti des païens, visant Paul en particulier. Jacques me dit «Mon frère, je suis fatigué de ménager les uns et les autres pour protéger notre petit troupeau» et il implorait Jésus de venir à son secours. Notre qéhila n’envoya plus de missions dans les Nations, nos émissaires partaient plutôt d’Antioche ou d’Alexandrie. Ainsi Pierre quitta Antioche pour Corinthe, puis Rome où, depuis la mort du César Claudius, les juifs commençaient à rentrer. Jean, nommé épiscope, partit pour Ephèse. Mon fils Yeshua s’embarqua pour Cyrène, où il avait passé son enfance. Les jeunes gens ne voulaient plus respirer l’air de la Judée. Mon fils Daniel s’établit près de Damas. Je restai à Jérusalem avec Tabitha pour soutenir Jacques sur le qui-vive.
Paul déclaré faux apôtre à propos du mode du baptême, des mots «Jésus, Seigneur», la foi et les œuvres
Jacques reçut une lettre dictée par Jean, qui accusait Paul. L’ekklesia d’Ephèse avait été formé par Apollos, un juif d’Alexandrie. Il enseignait avec zèle, baptisait par l’eau. Paul cria «ce n’est que le baptême de Jean !» et les persuada de se laisser imposer les mains au nom de Jésus pour prophétiser par l’Esprit. A la synagogue, les juifs de la Diaspora le laissaient parler de Jésus et démontrer par les Ecritures qu’il était le Messie. Mais ils furent scandalisés quand Paul appela Jésus «Seigneur». Les juifs disaient «Dieu seul est Seigneur!» Un autre jour, Paul s’écria «La Loi n’était qu’un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant que Christ est venu, les œuvres sont vaines, il n’y a plus d’autre loi que la foi, la Loi est morte !» Alors les israélites d’Ephèse le chassèrent. Pour les narguer, Paul loua une école près de la synagogue pour ses adeptes. Arrivant à Ephèse après Paul, Jean fut jeté de la synagogue par les juifs qui criaient «anathème !». Furieux, Jean faisait écrire à Jacques «d’où vient que ce tarsiote ose proclamer que le Messie a aboli la Loi ? Qu’il n’y a plus ni fêtes ni sabbats ? Manger tout ce qui se vend au marché ? Que nous ne sommes plus le peuple de la Promesse ?» Est-ce là ce que Jésus nous a enseigné ? Que Paul disparaisse de cette ville ! Car c’est moi, l’un des Douze, que les convertis de ce faux apôtre finiront par chasser !» Abattu, Jacques dit «si ceux du Temple apprennent ce qu’au nom du Messie Jésus, il dit dans les synagogues de la Dispersion, ils nous tueront! Je ne puis lui donner d’ordres car il n’obéit à personne. A nos communautés d’Asie et de Syrie, je parlerai de cette «justification par la foi» dont il s’est fait le défenseur contre les œuvres des fils d’Abraham. Mais je resterai loin de l’esprit de dispute de notre frère Jean. Jésus n’attend pas de moi que j’excite les querelles et les cabales». Jacques écrivit «mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il à la foi, s’il n’a pas les œuvres ? Si la foi n’a pas les œuvres, elle est inutile, (ce débat opposant Paul et Jacques, alimentera la querelle entre protestants et catholiques. Par «œuvres», il faut certes entendre «rites religieux» mais l’exemple donné par Jacques montre bien qu’il s’agit d’«actes charitables»).
Le codex comporte ici un feuillet très altéré, il manque aussi plusieurs feuillets. L’auteure en résume les événements.Des contre-missions furent envoyées en Anatolie, pour rétablir l’orthodoxie judaïsante partout où Paul avait prêché. Il n’avait respecté ni fait respecter le compromis du «concile de Jérusalem». Il disait même à ses convertis, qu’ils pouvaient consommer la viande des sacrifices païens. Apprenant ces contre-missions, il expédia à toutes ses églises des lettres violentes, ses émissaires furent mal reçus. Il adressa une longue lettre doctrinale aux chrétiens romains. Il osait prêcher les fidèles d’une communauté qu’il n’avait pas fondée, dans une ville qu’il ne connaissait pas, alors que Pierre et Sylvain étaient sur place. Se comportant en chef absolu de la «voie de Jésus», il semblait craindre cependant la réaction de Jacques.
Paul critiqué : « Jésus, Fils de Dieu » ; le joug de la Loi ; circoncision accusé au Temple ; arrestation
Jacques s’écria « Fils de Dieu ? Est-ce là ce que Paul a écrit ? Que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils ? Jésus est-il Fils de Dieu comme l’Apollon grec est fils de Jupiter ? Ceux qui sont conduits par l’Esprit sont tous fils de Dieu, mais un seul est Messie, voilà ce que Paul devrait prêcher ! » Je dis «ne le querelle pas, j’ai vu à Cyrène et Antioche que les païens comprennent mal ce mot de Messie : ils disent «Jésus-Messie» comme si c’était un seul et même nom, ils ne comprennent pas non plus «Fils de l’homme» car ils ne connaissent pas les oracles de notre prophète Daniel. Pour les aider à comprendre celui qui viendra s’asseoir auprès de «l’Ancien des Jours», Paul leur a peut-être dit Fils de Dieu ?» Jacques dit «les nazôréens vont se demander si Dieu a une fille, une femme des cousins ? Les juges du Sanhédrin diront que nous sommes des idolâtres ! Qu’écrit le tarsiote sur les juifs ?».Il écrit «ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude ! Ceux qui s’attachent aux œuvres de la Loi sont maudits ! Il nous appelle les faux circoncis (Ph 3,2), car les vrais circoncis, selon lui, ne le sont qu’en esprit».(Rm 2,29).Jacques : «prions et faisons prier, que nos frères le jugent irréprochable, qu’il accomplisse ici des œuvres qui feront taire la calomnie».
Paul implorait les frères de la Dispersion de prier avant que les «incrédules de la Judée» ne le mettent en pièces. Il avait prononcé le vœu d’abstinence et ne se coupait plus les cheveux, disant «je ne fais aucun cas de ma vie». Il continua de rapporter la collecte aux Pauvres de Jérusalem. Jacques lui dit alors «aux juifs qui vivent parmi les païens, tu enseignerais à oublier Moïse, tu leur dirais Le Seigneur a détruit la Loi, vous êtes libres ! Le Messie n’est pas le Seigneur, il est venu pour accomplir la Loi et non l’abolir. Aux Israélites de la Dispersion, tu dirais «vous n’êtes plus les héritiers uniques de la Promesse. Car, pour Dieu, il n’y a plus ni Juifs, ni Grecs. Et notre décret il y a 7 ans? Au Jour de Dieu, ceux qui auraient péché sans la Loi seraient jugés sans la Loi et ceux qui auraient péché sous la Loi seraient jugés par la Loi .Voici 4 hommes, tenus par le vœu, prends les avec toi, monte au Temple, avec eux, accomplis les 7 jours de purification. Ainsi tous sauront que tu respectes nos traditions et notre Loi.» Paul souscrivit à tout avec humilité. Grandes étaient ses fautes, mais il avait en lui, la lumière du Seigneur: un feu, une vivacité qui me faisaient désirer le croire. Sur l’esplanade des Païens, des juifs d’Asie reconnurent le converti Trophyme et crurent qu’il avait suivi Paul et les 4 pénitents dans la cour d’Israël, interdite aux incirconcis. Ils se ruèrent sur Paul, la foule se souleva. Les soldats délivrèrent Paul de ces furieux prêts à le tuer. Jacques dit aux Anciens «prions pour que ces furieux ne se tournent pas contre nous !» Je dis «prions pour Paul, livré aux soldats qui ont tué le Messie Jésus» Un frère dit «ils ne peuvent mettre à mort un citoyen romain». Des zélotes, hommes-poignards, voulaient tuer Paul, mais son neveu fut averti par les sadducéens du Sanhédrin qui craignaient d’irriter les Romains, Paul étant un citoyen romain. Il fut emmené à la prison de Césarée. Ne trouvant Paul, les zélotes décidèrent de marcher contre nous. Jacques fit fermer la maison, avec des Galiléens devant la porte. Jacques notre Rempart décida que ceux de notre qéhila ne se montreraient plus dans le Temple pendant un long temps. Aidé d’un bâton, lui seul continua d’y monter à la première heure pour la prière. Personne n’osait murmurer contre lui quand il passait.
La guerre des juifs colère de Jacques contre les grands Prêtres et les riches, lapidation de Jacques
C’est à Césarée, que survint la 1ère grande dispute entre les Juifs et les Grecs de la Judée. La ville avait été déclarée «grecque» à cause de ses temples par le jeune César, alors que pour les juifs, elle était juive car fondée par notre roi Hérode. Ayant perdu le droit d’en désigner les magistrats, ils se révoltèrent. Jérusalem s’enflamma. D’où la répression par le sang .Puis, la guerre se mit au sein du Temple. Les familles des grands Prêtres et sacrificateurs s’opposaient aux lévites, qui devenus très nombreux, murmuraient contre leurs partages. Aidés de brigands, les grands s’emparèrent des dîmes du blé réservées aux petits serviteurs du Temple qu’ils faisaient rouer de coups. En frappant les petits d’Israël, les Grands Prêtres foulaient aux pieds la justice des hommes et la Loi de Dieu. Certains disaient «Jésus était le nouveau Moïse, Jacques est le nouvel Aaron». Jacques osa affronter ceux du Temple, parlant publiquement contre les Grands prêtres pour les lévites et les ouvriers du Temple renvoyés. Cette année était le sabbat de la terre d’Israël (année 62) avec la pire des misères dans la ville basse. Le Rempart du peuple grondait contre les riches dans leur palais. On pensait moins à l’appeler «Genoux de chameau» que «Samson». (Epître de Jacques 2, 5-6 et 5, 1-6). Hânan, ben-Hânan, fit saisir Jacques au Temple. Profitant de l’absence du préfet nommé par César, il rassembla le Sanhédrin, accusa Jacques et d’autres d’avoir violé la Loi. Les Anciens dirent aux zélotes : «lapidons Jacques l’Impurqui reçoit dans sa maison des incirconcis et partage avec eux le pain d’Israël !». Après la 1ère pierre, tombant à genoux, Jacques priait le Seigneur. Un prêtre s’écria «arrêtez ! Le Juste prie pour vous !». Son corps bascula dans le fossé, sous la muraille. Vivant, il fut frappé à la tête jusqu’à la mort. Mes os tremblèrent : il nous conduisait dans les sentiers de la justice, et il était tombé sous les coups des injustes. Au roi Agrippa, on dénonça qu’Hanân avait transgressé nos règles. Des pharisiens rappelèrent au préfet que le Sanhédrin ne pouvait être rassemblé ni punir de mort sans la permission des Romains. Hânan fut destitué.
Le préfet ne put rétablir la paix dans la Judée : de faux prophètes et enchanteurs sortirent de partout, menant des indigents à la révolte, qui furent flagellés, massacrés par les Romains. Des zélotes faisaient libérer jusqu’à dix de leurs partisans contre un seul de leurs otages, riches parents du Grand prêtre. Oubliant l’enseignement de miséricorde du Serviteur de Dieu, nos jeunes voulaient détruire les rois, prêtres et préfets. Les fils de Jacques, mon fils Joël, et d’autres dirent «Jésus, le netzer de David, est mort pour racheter nos péchés, comme l’avaient dit les prophètes. Mais pour qui, pour quoi est mort Jacques le Juste ? Dans la détresse et l’affliction. Il me fallait fortifier les autres, d’abord Tabitha, celle que mes frères avaient d’abord rejetée, qui était plus attachée aux miens que moi-même.
Incendie de Rome, Persécutions des chrétiens, Mort de Pierre,
Ma fille Ruth prophétisa la destruction de Jérusalem et des Nations par le feu d’un dragon rouge. Pierre, notre Roc, restait à Rome, d’où Paul enfin libéré de sa captivité était parti prêché les barbares d’Espagne sans plus donner de ses nouvelles (l’exécution de Paul par Néron à Rome est une légende fondée sur un apocryphe de la fin du IIè siècle, dénoncé par Tertullien qui connaissait le faussaire, prêtre en Asie). Notre «colonne» me disait «Prends courage petit ! Car notre bien-aimé vient, maintenant, et la fin de toutes choses est proche : la mort de Jacques et les désordres de Jérusalem n’en portent-ils pas témoignage ? Ne crains pas la fournaise de l’épreuve. Rassemble ton troupeau pour le préserver du diable qui rôde». Rome, brûla dans un terrible incendie qui dura plusieurs jours. Quelques-uns de nos frères, dans le quartier juif, criaient «le monde s’embrase, le Seigneur approche, alléluia ! Convertissez-vous ! Respectez la volonté de notre Père !». La ville en cendres, certains accusèrent le César Néron d’y avoir mis le feu pour agrandir son palais. Il fut aisé aux magistrats de reporter l’accusation sur les christianoï, criant de joie. Pour connaître ce «Père» qui avait allumé l’incendie, on mit plusieurs des nôtres à la torture. Nos fidèles ne donnèrent aucun nom car «Son Nom ne peut être prononcé». Condamnés comme incendiaires et sans religion (les romains excluaient les sectes), le peuple criait «aux lions!» et certains furent envoyés dans l’amphithéâtre. La plupart, revêtus de tuniques enduits de poix, brûlèrent comme torches vivantes lors des fêtes de nuit de Néron César à ses amis. Beaucoup de nos frères de l’ekklesia romaine périrent dans les tourments, et parmi eux Simon, bar-Jonas, si fort de corps et de cœur que le Messie Jésus l’avait appelé «Pierre».
Autour de Jude, les ébionim attendent le Royaume massacres des juifs, des romains, des juifs
Jérusalem devint une ville où, à son comble, la haine des Nations était entretenue par les zélotes et les sadducéens, plus violents les uns que les autres. Nous ne montions au Temple qu’aux fêtes, je n’y enseignais plus, mais nous allions prier et exhorter dans les synagogues, avant de partager l’agape avec nos frères dans la paix de notre maison. Je regardais nos malheurs avec confiance, n’étaient-ils pas le signe que la Fin des temps approchait ?, que les prophéties s’accomplissaient ? Je rassemblais autour de moi la communauté, comme Jacques l’avait fait au lendemain de la mort du Messie : «nous voici au terme de 40 années de tribulations, nous allons sortir du désert où Dieu nous a maintenus pour nous éprouver (traversée du désert à la sortie d’Egypte, le Royaume promis était alors attendu pour le début des années 70). Veillons et restons prêts. Notre Sauveur est vivant et nos yeux le verront.
Ce que nous enfantons, c’est le Royaume !».
Le nouveau préfet était si avide et corrompu que les Israélites de la Judée refusèrent tous ensemble de payer le tribut à César. Ses troupes, face à l’opposition des zélotes retranchés dans le Temple pour en défendre le Trésor, pillèrent et tuèrent tous ceux qu’ils trouvaient. 3 600 juifs furent massacrés. Des principaux de la ville furent arrêtés et pendus au bois en dépit de leur rang. Le sacrificateur Eléazar fit ôter du sanctuaire toutes les offrandes d’or et d’argent que les Césars avaient autrefois déposées (sorte de rupture des relations diplomatiques) et dit «le Temple de l’Eternel est purifié, Israël est délivré ! Dieu des vengeances, creuse la fosse des méchants !». Aussitôt les rebelles prirent les citadelles de Machéronte et Massada, égorgèrent les soldats, brûlèrent le palais d’Agrippa, voulurent incendier celui du Grand Prêtre. Epouvantés, de vieux lévites nous demandèrent asile, car ils avaient aimé Jacques le Juste qui défendait les petits contre les grands. Deux demandèrent le baptême. La foule envahit la forteresse d’Antonia où s’étaient réfugiés les notables et le Grand Prêtre, cherchant la protection des soldats romains. En vain, plusieurs dont le plus puissant des Grands Prêtres, ayant gouverné le Temple 14 ans, voulurent s’enfuir par les égouts. Rattrapés, ils furent égorgés. La foule envahit l’Antonia, y mit le feu ainsi qu’au greffe des scribes où l’on gardait les livres de généalogie et les contrats de dettes.
Des soldats, manquant d’eau, se rendirent à Eléazar qui leur promit la vie sauve, mais les fit massacrer. Abomination, ceci fut un jour de sabbat ! Jérusalem s’étant libérée, les fils d’Abraham se soulevèrent partout, ravagèrent villes et villages des Syriens, ruinèrent Gaza et Gadara . Les Grecs tuèrent les Israélites demeurant dans leurs murs. Il ne resta plus un seul juif dans Césarée, où il y en avait eu 20 000. Les grandes villes de la Diaspora entraient en ébullition. Néron nomma Vespasien, l’un de ses plus vieux généraux, qui reprit la Galilée village après village, ravageant le pays. Soutenu par les hérodiens, le roi Agrippa servait de guide à l’armée romaine. Fuyant leurs communautés dévastées des bords de la mer Morte, des esséniens rejoignirent Jérusalem. Les pharisiens, emmenés par Yohanan ben-ZaccaÏ, leur plus brillant rabbi, migrèrent vers Jamnia peu hellénisée, proche de Jaffa. L’année suivante, 68-69, suite au suicide de Néron et aux difficultés de sa succession, Vespasien quitta la Palestine pour Rome. Elu empereur, son armée revint sous les ordres de son fils Titus. Mon frère José, malade, dit «frères ébionim, je demeurerai ici avec les vieillards et les infirmes. Fuyez sans vous retourner comme Jésus nous l’a recommandé pour le Dernier Jour»
Refuge à Pella
Laissant Jérusalem et ses villages, nous étions plus de 1000 à Pella, au-delà du Jourdain. Vinrent nous secourir des nazôréens, établis depuis le temps où Jacques de Zébédée y enseignait. Certains de notre qéhila se firent chez eux bergers, laboureurs ou tailleurs de pierre. Nos ébionim restaient pauvres parmi les pauvres, mais ils ne gémissaient plus, rendant grâce au Seigneur pour cet abri. Notre foi dans le Messie Jésus était devenue notre ville forte. Je restais inquiet pour mon fils Joël et mon scriptor Siméon, protégeant les Pauvres de Jérusalem, sous le commandement de José affaibli. Joël disait «imitons le Messie Jésus, qui préféra mourir par la croix que de tuer par l’épée».
Destructions et atrocités à Jérusalem mort de José, mort de Joël fils de Jude
Au début de l’an 70, l’étau se resserra sur Jérusalem. Assistées de milliers d’auxiliaires arabes, 4 légions, conduites par Titus, entourèrent les collines où s’étaient réfugiées plus de 600 000 personnes. De mi-avril à mi-septembre, Jérusalem fut assiégée. Face à la résistance des rebelles, Titus fit crucifier, face aux murailles, 500 prisonniers par jour. Par une enceinte autour de la ville, ni ravitaillement, ni fuite n’était possible. Vint la famine. Méthodiquement bombardée, la ville basse fut détruite. Les portes du Temple cédèrent, le Saint et le Saint des Saints furent incendiés. Le Temple fut rasé. Parmi les petites maisons de la ville haute encore debout, restaient 2 ou 3 murs de l’ancienne qéhilades judéo-chrétiens Vos mains sont pleines de sang, dit l‘Eternel. De ce sang-là, même les fils de Lumière s’étaient souillés. Pour faire advenir son Royaume, Dieu avait renversé les arrogants, des justes étaient tombés avec eux dans les pires atrocités.(Flavius Joseph). Des 2000 frères à Jérusalem, mon neveu Siméon, fut le seul qui avait rejoint notre qéhila en exil. Pour se protéger, il avoua avoir abandonné nos ébionim et tué par trois fois en Samarie. Je lui dis «frappe ta poitrine et prie. Notre Père sait par quelles épreuves tu es passé, et sa miséricorde est sans bornes» Il se rasa la tête, jeûna 49 jours sans rien prendre que de l’eau et des baies sauvages, nous priâmes ensemble, à la fin, je lui imposai les mains. Par lui, je sus la mort de mon frère José. Il dit «il est mort en saint du Seigneur et Jésus s’est montré à lui. José le voyait et lui parlait.» Je me dis «serai-je donc le dernier à n’avoir pas été visité par l’Elu ? M’en veut-il encore de n’avoir pas entendu la dernière parole qu’il m’a dite, sur le Golgotha ?»J’implorai son pardon, et lui rendis grâce d’avoir visité José. De Joël, l’enfant de ma vieillesse, Siméon ne savait rien. Quand, comment était-il mort ? Je lui dis «il nous l’apprendra lui-même, puisqu’il sera bientôt parmi nous. Le Royaume ne saurait tarder».
De retour de Jérusalem, il me dit «il n’y a plus de prêtres, lévites, sadducéens, esséniens, zélotes, hérodiens. Plus de baptistes, les rives du fleuve sont ravagées; plus de Parfaits du désert, brûlés avec leur village. Ne restent que nous avec les pharisiens, dont leurs Anciens sont à Jamnia, où leurs rabbis prospèrent. Certains sont revenus pour relever les murs des synagogues. Ils se demandent où se prosterner. Je dis «Nous savons depuis longtemps que notre Temple est notre qéhila. Peu importe la ville, Dieu nous entend pareillement. Je veux prêcher dans la Galilée et à Kokhaba où demeurent mon fils Daniel et ses enfants. Je rentrerai dans Jérusalem, quand Rabbi ben-Zaccaï y rentrera (chef des pharisiens, qui refonda le judaïsme). Je disais au Seigneur «maintenant que mes forces s’en vont, Abba, ne m’abandonne pas». Mais l’Eternel me jugea digne d’une autre épreuve: une autre guerre commençait, non contre les Romains, mais contre nos frères.
Divisions crées par Paul à propos de «Christ, fils de Dieu, est Seigneur» exclusion des synagogues
Des émissaires des ekklésiaÏ de Tyr et de Damas, hommes de division, vinrent en Galilée prêcher une parole de folie «Christ est fils de Dieu, Christ est Seigneur». Certains disaient «Christ n’est pas de ce monde, il n’a pas été engendré, son corps n’était qu’une apparence, il est le Fils descendu des Cieux pour enlever avec lui dans la Lumière ceux nés de la Lumière (annonce le gnosticisme, principale hérésie des IIè et IIIè siècles). Leurs lettres étaient de Paul, rappelant ses multiples souffrances (2Co 11, 22-23). Comblé d’injures et absorbé dans ma misère, je prêtai peu d’attention à ce nouvel outrage. D’autres lettres m’alarmèrent : «la Loi de Moïse est le ministère de la mort gravée sur des pierres». (2Co 3,7-8) Les enfants d’Israël réchappés des massacres allaient nous lapider ! Irrité, je dis «détruisez ces lettres ! Dieu a donné la clé de la maison de David, à moi, le dernier de la lignée. Quand je fermerai la porte, nul ne l’ouvrira !» Je fis écrire à toutes les communautés « Bien-aimés, la foi nous a été transmise une fois pour toutes et il n’y a pas de confusion dans l’enseignement du Messie. Il s’est glissé parmi vous des impies qui cherchent à vous diviser. Chassez-les et le Seigneur, quand il viendra, exercera son jugement contre eux». Qu’étaient devenues nos ekklesiaï de Césarée, Cyrène, Rome, Ephèse ? A quelle autorité obéissaient-elles ?
Après avoir prêché et baptisé dans le pays de Gôlan, j’appris que d’autres émissaires de l’Eglise d’Antioche, étaient venus semer l’ivraie jusque dans mon champ, confessant que Christos était fils de Dieu, et Dieu lui-même par l’Esprit. Il était Dieu descendu parmi les hommes ! Descendu dans la chair ! Eternel devenu mortel ! Nos Pauvres s’écrièrent indignés « Le Messie notre Maître est Jésus, bar-Joseph, de la maison de David, que Dieu a choisi parmi tous les hommes d’Israël lorsque Jean le Baptisa» (thèse « adoptianiste », qui concurrença celle de la conception virginale : Jésus devient «fils de Dieu» par élection divine lors de son baptême ou de sa Transfiguration). Ces querelles et rivalités entre ébionim et christianoÏ troublant la synagogue, les pharisiens dirent «allez, entre païens, vous disputer comme des chiens le corps de votre Ressuscité, allez manger sa chair et boire son sang, impies ! Que vos péchés retombent sur vos têtes !». Ils ne voulurent plus laisser les Israélites de la voie de Jésus lire et prier au milieu d’eux. J’étais abattu, ne souhaitant même plus conserver la vie. Tabitha, mon lys au milieu des épines, mourut et sur cette terre du Dehors, je dus la mettre dans une sépulture d’étrangers. Des Grecs de notre qéhila la prirent dans leur tombeau, car nos Israélites les mieux établis dans la ville, des convertis de Jacques de Zébédée, me dirent «ta femme, notre sœur dans la Voie, n’était pas née juive, nous lui laissions partager notre agape, mais nous ne pouvons partager la mort avec elle». J’étais comme de la paille foulée dans une mare à fumier.
Jérusalem en ruine rejet des nazôréens des synagogues Bonne Nouvelle de Marcus Soif de Jésus
Je savais qu’en Paul, il n’y avait jamais eu de perversité. Avant de monter à Jérusalem, je dis à nos ébionim «je sais de qui le Messie Jésus est fils, car moi le vieil homme aux cheveux de laine, je suis son frère selon la chair. Il est le Serviteur, il n’est pas le Maître. Il est le chemin, il n’est pas le terme du chemin. Il est parti en avant pour nous ouvrir le Royaume. Car grand est l’amour de Jésus pour nous, et grand l’amour du Père pour Jésus. Ne vous laissez plus troubler par des trompeurs à la langue perfide. Que Dieu notre Père soit notre appui !» Quelques-uns repartirent pour la Judée avec moi. La plupart, las des exodes, restèrent au-delà du Jourdain. D’autres quittèrent pour Béroë (Alep en Syrie, où fut une grosse communauté judéo-chrétienne), Ninive ou la Babylonie. La fille de Sion est délaissée comme une cabane dans une vigne, dit l’Ecriture. Dans Jérusalem, en ruine, les cadavres étaient livrés aux vautours.
Réfugiés dans des caves, on se mit à rebâtir, cultivant les jardins abandonnés. Je récitais les commandements de la Loi, nous lisions le recueil des paroles du Messie, nous chantions le Shéma Israël, et répétions les prières que le Béni de Dieu nous avait enseignées. Disant «Père», j’étendais les bras comme, lors de mes 8 ans, mon frère le charpentier prenait mes mains dans les siennes pour les élever. Qu’avais-je appris? Que la voie de Jésus est un chemin difficile qui progresse entre deux abîmes ? Sur cet étroit sentier, j’avançais comme l’aveugle qui tâtonne du bout du bâton.
Je donnai autorité sur notre qéhila à Siméon, rempli de sève et verdoyant. Tous les frères approuvèrent mon choix. Appuyé sur le bras de ma fille Ruth, je descendais encore dans les villages pour guérir les malades et annoncer la Bonne Nouvelle aux affligés. Les pharisiens criaient «voici les mînim ! Honte aux nazôréens, anathèmes et païens !. Ceux du nouveau Sanhédrin poussaient les petits du peuple à s’écarter de nous. Nous revenions à la maison abattus et humiliés, étrangers dans notre pays. Dans mon cœur, Jésus s’élevait contre la faiblesse de mon commandement: «Serviteur fidèle, tu as gardé mon trésor, mais serviteur timide, tu ne l’as pas fait fructifier. Je t’avais confié une vigne excellente, comment as-tu pu la laisser dégénérer ?» Les synagogues d’Israël ajoutèrent aux 18 bénédictions de la prière, une malédiction, la birkat ha-mïnim, que nous devions prononcer contre nous-mêmes si nous voulions rester parmi les Juifs : «Maudits soient les hérétiques ! Que leur orgueil soit brisé et humilié. Maintenant !» Si nos ébionim gardaient les lèvres closes, ils se dénonçaient devant tous. Certains de nos adeptes, ayant trouvé asile dans les petits villages de la Judée, furent ainsi contraints de renier leur foi et d’oublier jusqu’au nom du Messie Jésus.
Un jour, le fils d’un négociant chrétien d’Alexandrie désira voir Jérusalem. Ne voulant pas loger chez les juifs qui n’en voulaient pas, il nous fut envoyé par de pauvres villageois, ayant entendu que nous étions grecs. Il fut étonné dedécouvrir que des adeptes de la voie de Jésus pouvaient aussi être fils d’Israël et respecter la loi de Moïse. Il me montra un petit livre nommé codex, où se trouvaient, dans la langue des hellénistes, la vie du précurseur, Jean le Baptiste, et le récit de la mort du Messie. Au milieu, des paroles de Jésus, mises sans ordre. S’y trouvaient aussi des justifications de nos coutumes juives, écrites pour des païens ignorants. Il me dit «celui qui a écrit ce livre est un chrétien romain du nom de Marcus (le plus ancien Ev. écrit en 70-80, destiné aux Romains, moins diffusé en Palestine que celui de Matthieu)). Ce Marcus avait connu un serviteur de la Parole, qui lui-même avait connu le Seigneur ! En chair et en os !». Pour parler du Serviteur de Dieu, il disait «le Seigneur», comme ceux de Paul. Mais, pour prier l’Eternel, il disait Abba, comme moi. Pendant qu’il commerçait avec les centurions, je lus plusieurs fois le livret qu’il appelait Marci euangueliôn, «la Bonne Nouvelle de Marcus». Je reconnus que les plus véridiques de ces choses écrites venaient de Pierre. D’autres m’étaient inconnues, et je ne les trouvais pas exactes. Quant aux paroles que ce romain mettait dans la bouche de Jésus, beaucoup provenaient de mon propre livre de logia et j’en éprouvai le vain orgueil d’un enfant qui remporte la course sans s’être exercé. En lisant ce petit livre fait comme un manteau rapiécé, pauvre récit auquel manquaient tant de justes lumières, je fus transporté d’allégresse et touché aux larmes-comme celui qui, au terme du voyage, retrouve la maison de sa mère et le frère qu’il croyait perdu. Il approche enfin, ce Jour où chaque épi portera mille grains, où les enfants ne naîtront plus pour périr, où tous les pauvres seront comblés d’amour. Et mon frère Jésus sera parmi nous ! A mon oreille, il redira cette dernière parole que je n’ai pas entendue et je sortirai du tombeau. Comme la fleur espère la rosée, comme le désert espère l’eau, je l’attends.
Quand il viendra, qu’il ne me trouve pas désaltéré ! Je garde la soif.
Conclusion personnelle:
Je tiens à terminer la présentation de ce livre sur l’évocation du codex et de l’Evangile, Bonne Nouvelle, de Marc.
La dernière phrase de mon travail me tient particulièrement à cœur. Elle nous tourne vers la lumière de notre humanité appelée sans cesse à marcher, rencontrer et suivre Jésus Sauveur.
Ayant à peine retenu les prénoms des frères de Jésus dans Mt 13,55-56, je me suis sentie interpellée quand une amie de notre groupe œcuménique de lectures avait exprimé son coup de cœur pour ce livre dont l’auteure m’était complètement inconnue. A ce moment, nous étions loin d’envisager la guerre à Gaza, et je n’avais pas mesurée que la date du 4 avril choisie par commodité pour présenter ce livre, faisait partie du temps pascal. En fait, j’ai vécu carême 2024 avec Jésus entouré de cette «pâte» humaine, en ce 1er siècle, parmi les fils d’Israël, puis avec son Eglise naissante, ouverte aux Nations, au sein de vives tensions théologiques dans un contexte de violences inouïes tant politiques et économiques que religieuses.
Au-delà de l’imaginaire très documentée de l’auteure, je me suis sentie rejointe par la densité humaine, intense et plurielle, des personnages bibliques. Ce flot continu de dialogues m’a permis de relire certains passages des Actes des Apôtres, découvrir l’épitre de Jacques, repenser certaines notes de la TOB, pour mesurer la pertinence de celles indiquées par Françoise Chandernagor.
J’ai donc beaucoup médité, prié, vibré émotionnellement et spirituellement, vivant à la fois ces époques et la nôtre surtout par rapport à nos églises tourmentées et à Gaza.
Je ne me sens pas le courage de résumer une conclusion de l’auteure tant ses 40 dernières pages, qu’elle nomme l’atelier de l’auteur, sont importantes à découvrir. Elles concernent la pertinence de ses choix ainsi que l’approche et l’évolution historique-spirituelle des personnages clés, aux tempéraments si puissants et singuliers. Je ne peux que vous encourager à les lire en premier si vous n’avez pas le temps de lire tout le roman.
En tout cas je me suis promise de lire ne serait-ce que les Actes des Apôtres, du début à la fin, afin de mieux comprendre les douleurs de l’Eglise naissante, dont l’accouchement perdure de nos jours.