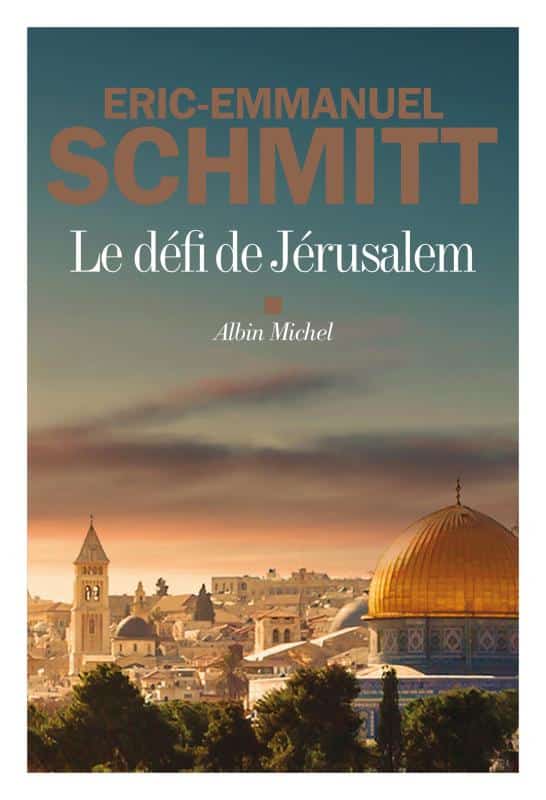Atelier de Lectures Oecuménique du 6 juin 2024
Gérard Houssin présente ses trois livres:
Les recommençants
Enfants de la Bible
Dieu, Marianne et les garçons
Pourquoi j’écris ?
On me demande souvent pourquoi j’écris. Je me demande moi-même pourquoi j’écris. J’écris pour témoigner, comme Jésus lui-même nous le demande : « Soyez mes témoins ». L’écrit est ma façon de témoigner de ma foi, de rendre ce que j’ai reçu.
Ainsi, dans mon premier livre, Recommençants, un chemin aux périphéries, j’ai raconté l’histoire de ma vie spirituelle, depuis l’enfance jusqu’à mon mariage avec Claude en 2013, avec cette longue période de 40 années sans Dieu suivie d’une conversion à l’abbaye de Tamié. Par ce livre, je témoigne de ma foi en expliquant son histoire.
Dans le second livre, Enfants de la Bible, mon propos n’a pas été de réécrire la Bible, comme certains ont pu le croire à tort. Mon objectif était de transmettre ma re-découverte des Ecritures, après 40 ans d’éloignement. Je suis comme un enfant qui aime à lire et relire une histoire tantôt belle, tantôt triste ou mystérieuse. Ainsi, j’ai cherché dans la Bible tous les passages où il était question d’enfant ou d’enfance. J’ai relu et repris ces récits d’une part à l’aune de ma foi retrouvée, d’autre part avec l’intention d’offrir cette lecture, cette foi, à celles et ceux qui n’ont jamais ouvert la Bible, ou presque, enfants et adultes, dans un langage le plus innocent possible. Innocent, au sens de nouveau, frais, sans à-priori.
Enfin, dans le troisième livre qui va sortir très prochainement, Dieu, Marianne et les garçons, je témoigne de ma foi auprès des enfants qui me liront, en adoptant au mieux leur langage et leurs questions. C’est l’enfant qui vit en moi depuis toujours qui s’exprime. Ce livre est un peu mon testament de chrétien aux enfants qui ignorent tout de Dieu, de la religion chrétienne. Il est d’ailleurs dédicacé à la petite fille de Claude dont les parents ne sont pas croyants, qui va entrer en septembre en sixième dans le collège catholique où sa mamie a enseigné, et qui s’est inscrite au catéchisme.
Je vais maintenant reprendre avec vous ces trois livres, non pas en vous en proposant un résumé, mais en vous lisant quelques extraits.
Recommençants, un chemin aux périphéries
Les premières lignes disent d’où je viens.
« Ma paroisse natale était idyllique. C’est là que je fus baptisé, un mois après ma naissance, dans une belle tradition fervente. Dans mon village de mille habitants, tous les habitants ou presque étaient de la même classe sociale, la classe ouvrière. Les ouvriers de mon village étaient tous des cheminots. Le sifflet et la fumée des locomotives cadençaient leur vie. La sonnerie des cloches de l’église aussi. Tous ne prenaient pas le train, et tous n’allaient pas à l’église. Tout le village respirait du même souffle, celui de la fraternité. Elle était le fruit tant de la culture ouvrière que de la ferveur religieuse.
Le curé parcourait en vélo tous les jours de la semaine, routes, rues et ruelles de ses paroisses, allant visiter les uns et les autres. Le dimanche, chacun lui rendait sa visite, à l’église. Ses prêches parlaient de « Dieu-au-milieu-de-nous », l’Emmanuel J’aimais le royaume des cieux sur ma terre. J’ai aimé rentrer au petit séminaire à dix ans, afin de vivre et de faire vivre à mon tour le Royaume des Cieux ».
J’ai quitté le séminaire et Dieu à vingt ans.
« Lorsque, en tant que séminariste, j’allais le dimanche dans les paroisses m’initier à la vie sacerdotale, Ma vision fut celle d’un clergé faiseur de sacrements, de prières, de bénédictions à la chaîne, prisonnier de sa cure. Je n’ai que trop peu vu de prêtres rayonnants, de prêtres envahis par la prière. L’Eglise et ses représentants ont défiguré mon idéal. A vingt ans, j’ai vomi ce trop-plein de fadeurs paroissiales, et j’ai claqué la porte, sûr qu’il me fallait bâtir un royaume ailleurs. J’ai séché mes larmes en me lançant à corps et à cœur perdus dans ma nouvelle vocation [, l’action socio-culturelle]. Pendant quarante ans, j’ai foncé tête baissée vers les hommes, dans une grande passion, sans doute pour ne plus regarder le ciel vide. J’ai traversé mes années de maturité sans regarder le ciel, les yeux dans les yeux des hommes mes frères, cœur à cœur avec ma petite famille. Ma situation sociale modeste m’a préservé des richesses matérielles du monde. Si ma Bible était fermée, elle est restée dans mes bagages, comme un cadeau précieux ».
En 2003, le décès de mon épouse m’ébranla.
« …Alors me secoua de ma torpeur le froid de février. Après des mois de douleurs, Marie Claire, mon épouse, s’éteignait au milieu de nous, mes enfants et moi, si sereinement que j’écrivis sur le faire-part « Marie a quitté son cocon terrestre ». J’eus la certitude à cet instant qu’elle renaissait dans un ailleurs, tel un papillon, une foi si forte que tout fut ébranlé en moi. Non, la vie ne se termine pas à la tombe, le monde ne se limite pas au visible, tout se poursuit autrement, dans une Eternité aussi impalpable que présente. La mort de mon épouse aura provoqué chez moi l’irruption de la question de Dieu, comme un coup de vent dans le silence blanc de l’hiver ».
L’abbaye de Tamié.
« J’ai eu la grande chance de retrouver une compagne, Claude…,à laquelle j’ai proposé que nous allions quelques jours à l’Abbaye de Tamié en Savoie…et là, il y a eu une rencontre. Il y avait si longtemps que je traquais le Divin qu’il fallait bien qu’Il m’illumine sans crier gare.
Le moine Jean m’attendait. « Savez-vous que Dieu vous aime ? » m’a-t-il demandé. Je savais que Dieu est Amour, mais jamais je ne m’étais dit qu’Il m’aimait. La question m’a fortement surpris. Mais Jean m’a expliqué que si je lisais l’Evangile, il fallait que je l’ouvre pour moi , en disant « Dieu n’a jamais refusé sa Lumière à qui La Lui demande ». A cet instant-là, les barrières que j’érigeais si fermement entre Dieu et moi sont tombées. Au terme d’une lutte, j’acceptai de Croire, je décidai de croire, et j’en fus très heureux. »
Les recommençants.
Il me fallait trouver un guide. Ce fut le groupe « parcours de la foi pour recommençants ». J’ai pu y exprimer mes doutes, mes convictions, voire mes colères dans un climat de confiance et de réciprocité. Ce fut aussi la lecture de l’ouvrage de Bernard Sesboüé, Croire, invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIe siècle. Toutes mes questions se trouvaient dénouées (et non pas résolues, je fais la différence) au fur et à mesure des chapitres. Puis je me suis lancé moi-même dans le guidage de recommençants à croire, une merveilleuse aventure.
Mariage
Fort de cette dynamique de re-commençant, je me suis marié avec Claude . Un re-mariage pour elle et pour moi. Nous étions soixantenaires. Ré-enchanter, reconnaître, révéler, relancer, être ravi, resplendir, se rassasier, remercier. Tels étaient les maîtres mots de notre cérémonie en l’église Notre Dame du point du jour à Lyon. Et nous avons rejoint les fondateurs du groupe de prière « Goûtons la Parole ». J’ai pris la présidence d’une association d’accueil de migrants.
Ce premier livre s’arrête là, avec le témoignage d’autres recommençants. Depuis, nous avons emménagé à Gleizé, et j’ai rencontré la paroisse protestante. Mais c’est une autre histoire.
Enfants de la Bible
Dans le second livre, Enfants de la Bible, mon propos, je vous le disais plus haut, n’a pas été de réécrire la Bible, comme certains ont pu le croire à tort. Mon objectif était de transmettre ma redécouverte des Ecritures, comme un enfant aime à lire et relire une histoire tantôt belle, tantôt triste ou mystérieuse. J’ai cherché tous les passages où il était question d’enfant ou d’enfance, avec l’intention d’offrir cette lecture, cette foi, à celles et ceux qui n’ont jamais ouvert la Bible, ou presque, dans un langage le plus innocent, le plus frais possible, sans à-priori.
Je vous offre quelques extraits. D’abord des dialogues improbables entre Jésus enfant et son cousin Jean-Baptiste. Des histoires qui ne sauraient auréoler le « petit Jésus » comme ce fut la mode au XIXe siècle, mais qui veulent plutôt s’ancrer dans le langage des enfants du XXIe siècle. Des histoires qui provoqueront sans doute un effet miroir.
Par exemple, je cite :
« – On dirait que je s’rais Dieu ! déclara Jésus.
– Et moi, dit Jean-Baptiste, on dirait que je s’rais Moïse ! – Non, pas Moïse, il est trop vieux !
– Alors, Elie !
– Non, il ronchonne tout le temps !
– Alors, reprit Jean-Baptiste, on dirait que je s’rais le nouveau prophète de Dieu.
– Oui, super, on inventerait des nouveaux jeux divins !… Et maintenant, en fait, qu’est-ce que je fais ? interrogea Jésus, soudain désarçonné par l’ampleur de son rôle.
– Eh bien, tu joues ! On joue à Dieu qui joue avec son nouveau prophète. C’est facile !
– D’accord, dit Jésus, en route !
Ils enfourchèrent leurs ânes et partirent au simple galop.
– Halte ! cria Jean-Baptiste, après une longue chevauchée, on est arrivés.
– Oui, je reconnais l’endroit. C’est là qu’est le secret du mystère de Dieu.
Jésus et Jean-Baptiste entrèrent sans bruit dans l’atelier de Joseph et se glissèrent discrètement sous l’établi.
– Regarde, dit Jésus, en montrant les monceaux de copeaux de bois jaune sable, c’est là ! Le secret est dans le désert de sable !
– Tu n’as pas vu les enfants ? demanda Marie en entrant dans l’atelier, je les cherche partout. Je suis allée à la fontaine puiser de l’eau pour les baigner. Demain, on les emmène à la synagogue, n’est-ce pas ?
– Regarde, Marie, répondit Joseph, ils sont là. Ils se sont endormis sous mon établi. Ils étaient épuisés. Il est vrai qu’ils avaient combattu des démons dans le désert. Je les ai écoutés, c’était un vrai bonheur !
Ils prirent chacun un enfant dans leurs bras, les portèrent jusqu’à leur couche, les contemplèrent longuement, puis se regardèrent avec douceur les yeux dans les yeux.
-Bonne nuit, Marie. -Bonne nuit, Joseph. »
Autre petit dialogue :
« -Tu aimerais être célèbre, Jésus ? – Comme Moïse ou Elie ?
– Encore plus ! Être connu dans le monde entier. On dirait : «Approchez, approchez tous ! Faites cercle ! les petits devant, s’il vous plait. Voici l’homme le plus fort du monde ! Il a vaincu… » T’aurais vaincu quoi, Jésus ?
– Papa dit que Moïse était très fort, plus fort que Pharaon et que la Mer Rouge. Maman préfère Elie qui a rempli de la crainte de Dieu tous les rois et a disparu dans le ciel. Impossible d’être plus fort qu’eux. Je sais ! Au lieu d’être plus fort, je serai celui qui connaît quelqu’un ou quelque chose que personne ne connaît. Voilà ! Je serai…je serai l’homme qui connait personnellement Dieu.
– Mais les prophètes eux aussi le connaissent, puisqu’Il leur parle.
– Oui, mais moi je Le connaitrais per-so-nnel-le-ment ! Tu comprends, JB ? Tu vois, déjà, Dieu, il est célèbre sans être connu, parce qu’il est invisible. Moi, je serai célèbre parce qu’avec moi, il serait visible.
– Et tu raconteras tout ce qu’il y a dans le Royaume de Dieu, même les mystères, ajouta Jean-Baptiste.
– Tu crois que les gens me croiront ? ajouta Jésus. Il faudrait quand même que je fasse quelque chose d’unique, que je vainque quelque chose de puissant. Puissant comme quoi, Jean-Baptiste ?
– Demande à Dieu, c’est lui qui te le dira !
– Il faut prier, tu crois ?
– Bien sûr ! Et puis…Oui, il faut que tu traverses des épreuves, comme les prophètes qui risquaient leur vie. Voilà, j’ai une idée d’épreuve pour toi, dit Jean-Baptiste. Si tu veux, demain, nous irons jusqu’à la rivière, je te réserve une surprise. Et le lendemain,
– Magnifique ! dit Jean-Baptiste, c’est exactement comme cela que je voyais la rivière pour ton épreuve. Voilà, tu vois le bassin qui s’est formé sous le rocher. Est-ce que t’es cap de monter là-haut et de plonger dans l’eau ?
– Et toi ?
– C’est toi le héros, pas moi. T’es cap ?
Jésus escalada le rocher, s’immobilisa, joignit ses mains au-dessus de sa tête, sourit aux anges, prit sa respiration, plia le buste, et d’un bond, sauta dans le vide. Son corps pénétra dans l’eau bien à la verticale et disparut. Les secondes s’écoulèrent. Soudain, le corps de Jésus émergea dans un bouillonnement.
– JB, cria Jésus, j’sais pas nager ! Au secours !
Jean-Baptiste descendit vivement dans l’eau et lui tendit une longue perche qu’il avait arrachée à un bosquet.
– Accroche !
Dans un mouvement désordonné, Jésus se saisit de la branche que Jean-Baptiste tira avec force vers la berge.
– Alors, tu as plongé dans l’eau sans savoir nager ? Tu as bravé la mort, Jésus, t’es trop fort ! T’as gagné ta première épreuve, ouf ! En fait, c’était ton baptême de plongeon.
– Et c’est toi qui l’as organisé, Jean-Baptiste, et tu m’as sauvé. Moi, je dirais plutôt que c’est ton baptême de prophète ».
Ces dialogues sont suivis de récits librement inspirés de passages de la Bible. On rencontre ainsi l’enfant Caïn, l’enfant Isaac, les deux fils de Rébecca Esaü et Jacob, l’enfant Samuel, mais aussi l’enfant prodigue, l’enfant Zachée, et bien sûr l’enfant de Bethléem.
Je cite un extrait du chapitre intitulé Nés prophètes :
« Il est au ciel, une table où siègent les prophètes qui partagent le dialogue permanent des trois personnes de la Sainte Trinité. Elle jouxte, d’un côté, celle des patriarches qui écoutent ravis la conversation, et contemplent, radieux, l’Alliance sans cesse renouvelée qu’ils ont initiée pour les temps éternels, et de l’autre, la petite table ronde d’un couple d’amoureux, Marie et Joseph. Les anges alentour guident une ronde ininterrompue d’invités qui chantent leur bonheur et dansent la Parole en ce royaume appelé par les hommes « Paradis ». « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté », déclame l’un, « O Freunde, Freunde ! », chantonne un autre, « J’ai fait un rêve », entonne le suivant, « Alléluia ! » clame la foule innombrable.
Moïse passe volontiers d’une table à l’autre, s’assoit tantôt ici, tantôt là, léger comme un enfant qui s’émerveille, muet d’extase. Touche-t-il l’épaule d’Abraham ? Les douze tribus d’Israël s’avancent en procession jusqu’au temple de Jérusalem. S’approche-t-il d’Elie ? Un feu illumine ses yeux. S’arrête-t-il près de Jésus ? Un frêle berceau de paille glisse jusqu’à une croix flamboyante. S’il avise Jonas, la mer étincelle, et s’il croise Jean-Baptiste, l’eau et le sable ruissellent en perles fines. S’attarder près de David, c’est voir s’illuminer l’Arche et jaillir l’arbre dont la ramure effleure Joseph, ou bien créer l’envol sonore d’une myriade de cantiques. Regarder Marie, c’est faire chanter la terre et le ciel d’allégresse. Surprendre enfin Pierre et Paul, c’est écouter la louange de l’Eglise.
Si Moïse invite ses amis les prophètes à plus de confidences, ceux-ci se penchent sur l’enfance de leur vocation, et rouvrent la source.
– Ma mère Anne, confesse simplement Samuel, m’a conduit jusqu’à l’autel où les anges de Dieu m’ont appelé trois fois par mon nom, « Samuel ! », et j’ai répondu « Me voici, Seigneur ! ».
– J’étais blotti dans ma grotte, raconte Elie. Et voici que Yahvé me commanda de sortir à sa rencontre. Un grand ouragan souffla, puis un tremblement de terre secoua la montagne, suivi d’un gigantesque feu. J’avais beau écarquiller les yeux, Yahvé n’était pas là. Enfin, je l’entendis. Il était dans la douceur de la brise légère.
– Comment dirais-je, Seigneur, tous les bienfaits dont tu m’as comblé ? S’exclame Isaïe. Je risquerais alors d’être le plus bavard de tous tes prophètes. Tu as purifié mes lèvres pour que ma bouche invite ton peuple chéri à la purification du cœur. Je l’ai incliné à croire en la naissance d’un enfant pour sauver le monde, aujourd’hui et pour toujours. Tu m’as tiré les larmes avec ces mots tendres avec lesquels tu consoles ton peuple : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ! » Chaque jour, je célèbre tes grandeurs, Alléluia !
– « Cherche, et tu vivras » ai-je entendu de Yahvé, dit à son tour Amos. C’est un commandement que j’ai transmis avec bonheur, car il va bien à l’enfant curieux que je suis toujours.
– L’enfant ! J’ai aimé l’enfance que j’ai partagée avec toi, Jésus, dit Jean- Baptiste. Je t’ai connu dès le ventre de ma mère, tu le sais. Tout petit, j’étais déjà ton prophète. Nous avons partagé les mêmes jeux, puis les mêmes enjeux. A la mort, à la vie ! Je t’aime, Jésus.
– Tu sais bien que je t’aime, repris en écho Pierre, approuvé de la tête par Jean et Paul. Nous sommes comblés d’avoir donné, par toi, naissance à ton Eglise. Ecoute-la prier, dirent-ils en chœur.
– Et moi, dit enfin Moïse, tu as piqué ma curiosité, Yahvé, avec ce buisson ardent que j’ai osé approcher, les pieds nus. Ta voix m’a saisi de crainte puis de force pour aller délivrer ton peuple pour lequel je me suis pris d’amour. Avec toi, avec lui, j’ai traversé marées, monts et déserts jusqu’au port. Quel voyage fabuleux !
De la foule des saints qui dansaient de joie, des voix s’élevèrent.
– Jésus que ma joie demeure, chanta Bach, entouré de la ribambelle de ses enfants. Sous mes doigts missionnaires, la musique a tant révélé ton Royaume
qu’on a osé dire avec ingénuité « S’il y a quelqu’un qui doit tout à Bach, c’est bien Dieu !» Je te présente mon Offrande Musicale, Seigneur.
– Je t’ai cherché dans l’infamie de ma vie, murmura Baudelaire. Des miasmes morbides j’ai extrait la splendeur afin de distiller Les Fleurs du Mal, et j’ai enfin trouvé ce vert paradis enfantines. des Amours
– J’ai eu souci de ton Eglise, dit Martin Luther. Ta colère m’a embrasé, comme elle avait saisi tes prophètes. Bienheureuse colère qui a éclairé le visage de tes enfants et rouvert la source.
Une toute petite voix féminine se fit enfin entendre.
– Tu le sais, Jésus, j’ai vécu le paradoxe le plus drôle qui soit, dit Thérèse de L’Enfant Jésus, d’une petite voix rieuse. J’ai été missionnaire du monde entier sans jamais sortir de mon carmel. Tu es adorable, Jésus !
– Nous nous sommes pris d’amour pour les petits, disent ensemble François d’Assise et le pape François. Qu’ils soient les guides de ton Eglise, Jésus !
Moïse s’en retourna prendre sa place à la droite de Jésus et lui dit à l’oreille :
– C’est fou comme nous nous ressemblons, n’est-ce pas ? Moi, sauvé des eaux, nouveau-né fragile, né pour sauver les Hébreux de l’oppresseur. Et toi, Jésus, « Dieu sauve », fils de l‘homme né pour sauver le monde de l’oppression du péché…
Au ciel, il est une table autour de laquelle le chœur de tous les élus, prêtres, prophètes et rois, accompagné des anges et des tout petits, proclame sans fin :
Notre Père, ton nom est sanctifié, car tu es tout puissant d’Amour et tu rayonnes à jamais. Tu nous combles de ta vie, et nous partageons dans la communion des saints ton amour inconditionnel. A toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Amen, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »
Dieu, Marianne et les garçons,
Bienheureux les catéchistes en herbe
Et pour terminer, je vous donne la prime heure du troisième livre qui, si tout va bien, devrait sortir le 19 juin chez le même éditeur. Il s’intitule Dieux, Marianne et les garçons, avec un sous-titre Bienheureux les prophètes en herbe. J’ai cherché là à témoigner de ma foi auprès des enfants, en adoptant au mieux leur langage et leurs questions. C’est l’enfant qui vit en moi depuis toujours qui s’exprime. Ce livre est un peu mon testament de chrétien aux enfants qui ignorent tout de Dieu et de la religion chrétienne.
Le livre est l’histoire de trois enfants qui cherchent à répondre à la très sérieuse question suivante : comment est-il possible de transmettre la foi si c’est Dieu qui la donne ? Deux enfants, des garçons, sont chrétiens et la troisième, Marianne, pas du tout.
Je cite :
« — Non, je n’ai pas le droit, Pierre ! Je n’ai-pas-le-droit ! répliqua vivement Marianne.
— Et pourquoi ? Qui t’a dit ça ? questionna son cousin Pierre.
— Personne, mais je le sais. Il faut être, comment vous dites, les chrétiens, il faut être batissé. Il n’y a qu’eux qui ont le droit d’entrer dans les églises.
— Baptisé, pas batissé. C’est pas du fil, c’est de l’eau. On fait couler de l’eau sur la tête, c’est après qu’on prend un tissu pour essuyer.
— Toi tu connais tout dans les églises, reprit Marianne. Moi, rien. Mes parents disent qu’ils sont d’abord et avant tout laïcs, et que Dieu, c’est pas pour eux. Alors que les tiens, mon oncle et ma tante, ils préfèrent être d’abord chrétiens. Ils s’entendent tous bien quand même, sauf quelquefois. Ça discute fort, tu sais bien. Par exemple, quand ils disent que l’église, elle est toujours fermée, alors que c’est un bâtiment public. Sauf le dimanche, pour les gens qui viennent, bien habillés. Alors que la mairie, juste en face, on peut y aller tous les jours.
— Sauf le dimanche, contesta Pierre, alors que l’église, elle est souvent ouverte le samedi pour les mariages. Tous les invités et les mariés s’engouffrent d’abord dans la grande salle de la mairie. Ensuite ils traversent la rue, escaladent les marches de l’église, entrent en procession, font la cérémonie qui est un sacrement. Après, ils ressortent pour les photos et les grains de riz. Tout fonctionne le samedi, la mairie et l’église.
— J’en ai vu qui n’escaladent pas les marches, reprit Marianne. Ils filent direct au bistrot et rappliquent pour les photos. Je pense qu’ils ne doivent pas être batissés, euh, baptisés. Une fois, j’ai cru que j’allais y entrer à l’église, quand mon grand cousin s’est marié. Mais il n’y a eu que la mairie et le bistrot. C’était bien aussi, car je n’étais jamais rentrée dans le bistrot. Mon père m’a fait goûter
du Champagne en disant : « Bois, c’est meilleur que le vin de messe ! ». C’est quoi, le vin de messe, c’est à l’église ?
— Oui, c’est le curé qui le boit, tu verrais ça, dans une belle coupe qui brille : un calice. Et il a des beaux habits, des verts, des rouges, des blancs. Moi, je peux tout te faire voir, si tu veux.
— Mais je n’ai pas le droit.
— Tu as le droit ! Moi je te dis. Personne ne contrôle, d’ailleurs. Même le mendiant, Patrick, il rentre. Il monte au premier rang, et parfois il fait des commentaires à haute voix. C’est drôle. Et il communie en disant trois fois « Amen ».
— Il dit quoi ?
— « Amen », ça veut dire, d’accord, merci. Ecoute, dimanche, je passe par chez toi et tu me suis à la messe. Je t’expliquerai tout. Le baptême, les habits en couleur, la communion, la procession avec la croix. Je connais un coin de l’église où on peut se glisser, tranquilles, sans être ni vus ni entendus.
Voilà pourquoi le dimanche 14 juillet, Marianne avait signifié à son père, directeur le l’école laïque, qu’elle serait parmi les volontaires pour aller à la messe.
—Psitt ! Marianne ! Là, derrière le pilier, ! lance Pierre à sa cousine.
Les deux enfants se dissimulent dans la chapelle latérale où sont stockés des
débris de chaises et des bancs hors d’usage.
— Là, tu verras tout. Chut ! murmura Pierre.
— Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
— Celui qui a parlé, c’est le curé, hein ? dit Marianne, le sourire aux lèvres. Je le connais. Il s’appelle Timothée. Il vient à l’atelier théâtre avec nous à la MJC. Qu’est -ce qu’il a dit ? Le père du fils de qui ?
— Oh là ! Tu commences fort avec tes questions. Il a parlé de la Trinité. Le curé a eu du mal à nous expliquer la Trinité, il bafouillait un peu avec des grands mots que j’avais jamais entendus. Mais je crois que j’ai compris. Par exemple, toi, Marianne, ça t’arrive d’avoir l’impression d’être deux dans ta tête, quand tu te poses des questions. C’est comme si tu te parlais à toi-même, toi et une autre toi.
— Oui, c’est comme si on était deux Marianne, qui cherchent à savoir ce que l’autre pense ou aime.
— C’est marrant ce que tu dis, trop fort ! Eh bien, Dieu, il est encore plus fort. Il est trois, dans sa tête, mais les trois ont un nom. Au lieu de s’appeler Marianne, Marianne et Marianne, ils s’appellent Le Père, le Fils et le
— Et le sain d’esprit !
— Non, le Saint Esprit. Et le curé, pour commencer la messe, il appelle Dieu
par ses trois noms pour qu’il vienne. — Waouh ! Il va venir là ?
— Oui, un plus tard, je te dirai.
A ce moment, une mélodie interrompit leur discussion. Tout le monde chantait « Seigneur, prends pitié ! »
— On attend un Seigneur ? s’inquiéta Marianne.
— Seigneur, c’est un autre nom de Dieu. Comme il est fort, tellement fort, on l’appelle Seigneur, pour l’inviter à venir. Mais je suis sûr que tu vas me demander pourquoi on lui demande de prendre pitié de nous ?
— Oui !
— Tu as peut-être entendu le mendiant, Patrick, dire à la porte de l’église : « Ayez-pitié ! » ?
— Oui, il est souvent là. Il est assis par terre, il se fait tout petit, on lui marcherait presque dessus. Quand il dit : « Ayez pitié », moi, je crois qu’il dit : « Attention, vous êtes grands et vous ne me voyez pas, faites attention à moi !
— Tu as tout compris, Marianne. Les gens disent à Dieu qui est grand de faire attention à eux qui sont tout petits. Mais ils le chantent, pour que cela lui fasse plaisir, au lieu de l’ennuyer.
— C’est sympa ! Et tu crois vraiment qu’il va venir, Seigneur, Dieu, Père, Fils, Saint Esprit et tout ça ?
— Patience. Ecoute ! maintenant, le curé va nous raconter une histoire et l’expliquer.
Stop ! J’arrête là ma lecture. Si vous voulez connaitre la suite, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Marianne trouvera-t-elle la foi ? Le suspens est entier jusqu’à la dernière ligne. Pierre et son complice François ne ménagent pas leurs efforts pour communiquer à Marianne tout leur savoir, au fil des jours et du calendrier liturgique, de l’Avent à la Résurrection »
Mais la foi ?